Le Parlement enquête, le droit vacille
Pour une clarification du cadre juridique des commissions parlementaires12 propositions
Introduction
Un arsenal inégal à l’exécution fragile
Convocation obligatoire, déposition incertaine
Un précieux pouvoir d’accès aux documents
Témoins piégés, garanties trouées
Un droit à l’avocat ?
Un droit au huis clos ?
Un droit au silence ?
Les conséquences du faux témoignage
Un droit de rectification du compte rendu ?
Assurer le suivi de l’enquête
Suppression de l’irrecevabilité judiciaire ?
Conclusion
Résumé
Cette contribution analyse la montée en puissance des commissions d’enquête parlementaires dans un contexte d’affaiblissement institutionnel. Confrontés à une impuissance législative, depuis quelques mois, les parlementaires investissent massivement la fonction de contrôle, parfois au détriment des garanties procédurales.
En effet, ce recours intensif aux commissions d’enquête déborde fréquemment le cadre juridique prévu, notamment en matière de convocations, de respect du droit au silence, d’accès à un avocat ou de tenue des auditions à huis clos. Il alimente les communications médiatiques et favorise souvent leurs excès.
Aussi pour préserver leur légitimité démocratique, sans réduire leur efficacité, l’auteur propose-t-il douze réformes. Elles visent à clarifier le droit applicable, à renforcer la protection des témoins et à créer un dispositif de suivi parlementaire. À défaut d’un encadrement adapté, le risque est grand de voir cet outil perdre en singularité et en puissance, jusqu’à devenir un simple rouage routinier du débat public. Ce plaidoyer invite ainsi à repenser l’articulation entre incidence politique et respect des droits fondamentaux, dans une démocratie en quête de crédibilité et de régénération institutionnelle.
Jean-Jacques Urvoas,
Professeur de droit public à l’Université de Brest, ancien garde des Sceaux, ancien président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale.
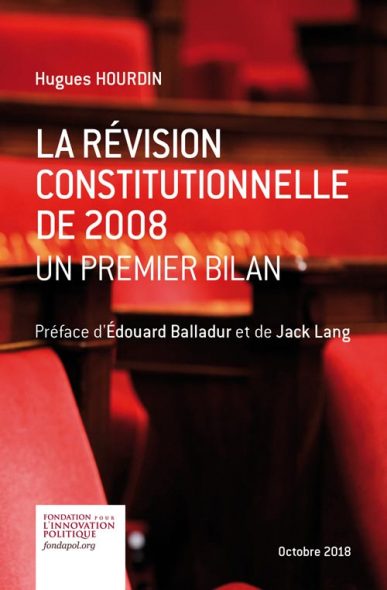
La révision constitutionnelle de 2008 : un premier bilan
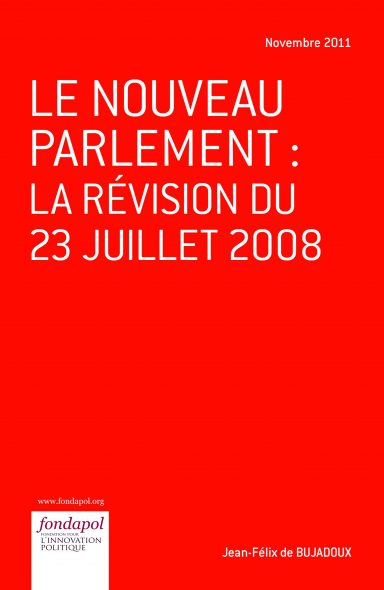
Le nouveau Parlement : la révision du 23 juillet 2008
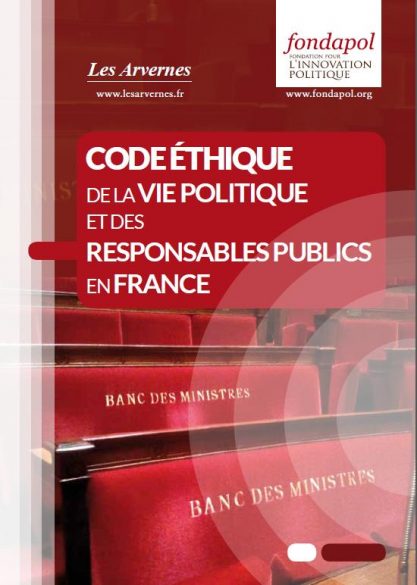
Code éthique de la vie politique et des responsables publics en France
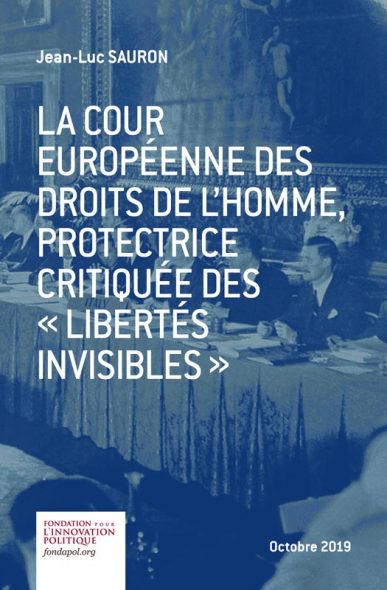
La Cour européenne des droits de l'homme, protectrice critiquée des « libertés invisibles »
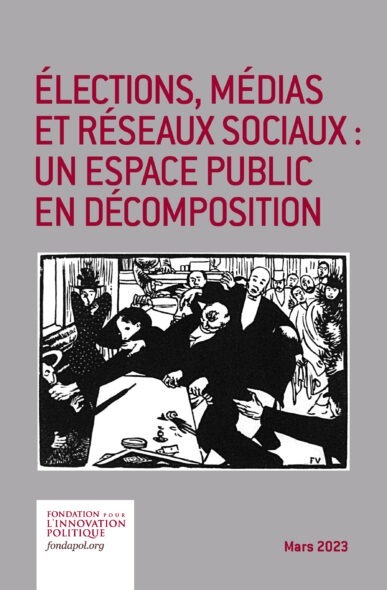
Élections, médias et réseaux sociaux : un espace public en décomposition
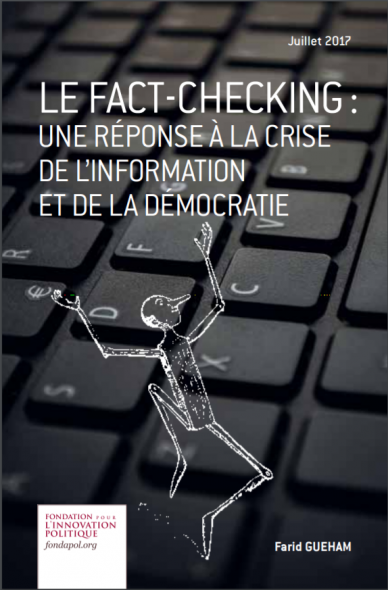
Le fact-checking : une réponse à la crise de l’information et de la démocratie

L’histoire des think tanks
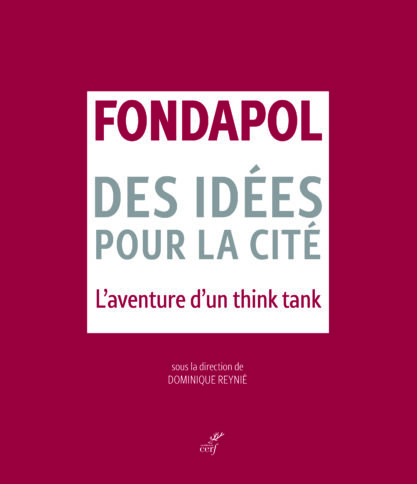
Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank
12 propositions
Proposition n° 1 : Subordonner les convocations à une motivation claire fondée sur un intérêt public avéré, les adosser à un questionnaire préalable formalisant l’objet de l’audition ; instituer un contrôle a posteriori des refus, confié à une tierce autorité (déontologue, Bureau, ou commission ad hoc), pour qualifier les détournements manifestes.
Proposition n° 2 : Reconnaître aux anciens présidents de la République le droit, s’ils le souhaitent, de témoigner devant une commission parlementaire d’enquête, avec la faculté, s’ils le préfèrent, d’exercer cette prérogative par écrit.
Proposition n° 3 : Instaurer un devoir de discrétion temporaire interdisant toute communication publique portant sur les travaux en cours jusqu’à l’adoption du rapport final, afin de préserver la sérénité des débats et la légitimité de ses conclusions.
Proposition n° 4 : Reconnaître que « pour l’exercice des missions, le rapporteur a libre accès à tous les documents utiles à l’exception de ceux protégés par un secret ».
Proposition n° 5 : Reconnaître explicitement le droit pour toute personne auditionnée de se faire assister par un avocat.
Proposition n° 6 : Reconnaître à toute personne auditionnée la faculté de solliciter le huis clos, en invoquant des motifs liés à la protection de ses droits fondamentaux ou à l’existence de rapports hiérarchiques sensibles.
Proposition n° 7 : Reconnaître expressément le droit pour toute personne auditionnée devant une commission d’enquête de ne pas répondre à une question lorsqu’elle estime que sa réponse est susceptible de l’exposer à une sanction pénale ou disciplinaire.
Proposition n° 8 : Articuler le serment avec un droit au silence bien délimité, sans le vider de sa substance.
Proposition n° 9 : Reconnaître un droit à la publication des observations annexées au compte rendu.
Proposition n°10 : Création d’un dispositif de suivi parlementaire des recommandations issues des commissions d’enquête.
Proposition n° 11 : Intégrer un article 51-2 nouveau dans la Constitution pour mettre fin à l’interdiction de principe frappant les commissions d’enquête lorsque des poursuites judiciaires sont en cours.
Proposition n° 12 : Créer un mécanisme de règlement des conflits de compétences entre le Parlement et l’autorité judiciaire confié au Conseil constitutionnel.
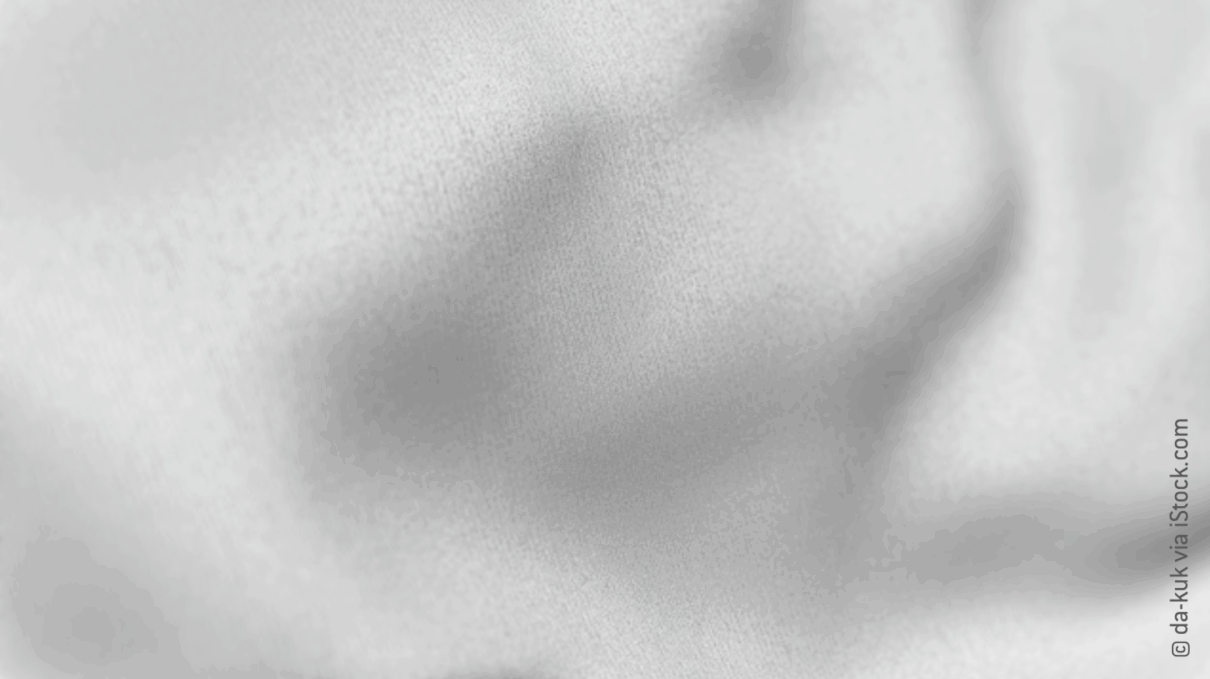
Introduction
Anne Charlotte Dusseaux, « Commissions d’enquête : un outil de contrôle parfois détourné à des fins politiques ? », LCP, 9 juin 2025, [en ligne].
Ces derniers mois, les critiques se sont multipliées : les commissions d’enquête parlementaire auraient outrepassé leur mission de contrôle, virant à la dénonciation. « Les députés jouent les procureurs pour pouvoir exister » dénoncent les uns1, ces instances se sont « transformées en tribunaux de l’Inquisition »2, voire en « mini-Vychinski numériques »3 protestent les autres.
L’unanimisme frappe, sa sévérité interpelle. Ces condamnations sont-elles justifiées ? Et si le diagnostic est avéré, quelles solutions ?
Pour comprendre cette mise en accusation soudaine, encore faut-il la replacer dans son décor institutionnel. Car ces griefs ne surgissent pas dans un vide politique. Ils s’inscrivent dans un moment de fragilité sans précédent de notre histoire.
Il y a un peu plus d’un an, une dissolution brutale et encore largement incomprise ouvrait la XVIIe législature de la Ve République. Depuis, au fil des mois, le régime semble se fissurer sous l’accumulation des désordres.
Le Président paraît embourbé, terriblement isolé et finalement dépourvu de toute capacité d’action réelle. Les gouvernements parlent sans agir et le Parlement s’enlise, divisé entre une Assemblée nationale incapable de faire émerger une majorité positive et un Sénat figé dans son rôle de gardien.
Dans ce climat d’atonie législative, le contrôle parlementaire a pris une ampleur inédite. Si entre 2017 et 2019, 196 rapports (issus de missions d’information, commissions permanentes ou d’enquêtes) furent publiés à l’Assemblée, entre 2022 et 2024, ce volume fut porté à 279. Et depuis 2024, pas moins de 69 rapports sont déjà disponibles4. Un tel engouement est révélateur : les élus déplacent leur centre de gravité. Faute de pouvoir peser sur la loi, ils investissent la fonction de contrôle, trop longtemps négligée. C’est là que s’exprime désormais leur exigence : contraindre le gouvernement à mieux justifier ses choix.
En elle-même cette évolution de principe est heureuse. Elle indique que la fonction de contrôle peut s’épanouir – enfin – dans un contexte fondamentalement différent de sa conception traditionnelle en France. Elle ne se limite pas à une bataille incertaine entre législatif et exécutif, ni même entre opposition et majorité. Elle marque la capacité des pouvoirs publics à inventer collectivement une pratique politique propre à rapprocher l’action de l’État des attentes des administrés.
Les commissions d’enquête occupent une place particulière dans ce tournant. Historiquement, leur légitimité découle du droit d’initiative législative : qui prétend faire la loi doit pouvoir en comprendre les enjeux. Pour légiférer utile, il faut savoir et donc enquêter. Mais avec la même constance, les parlementaires, souvent zélés, ont parfois peiné à contenir leur élan : plutôt que d’éclairer, ils ont cherché à orienter. À vouloir interroger, ils ont régulièrement débordé leur rôle, flirtant avec l’ingérence, voire rêvant de supplanter l’exécutif. Comme l’écrivait Michel Debré en 1955 : « Les commissions d’enquête exercent […] un rôle particulier. On y mêle les passions politiques, avec leur utilité et leur nocivité, tantôt à la Justice, et tantôt à l’Histoire »5.
Il n’est donc pas tout à fait nouveau que leur déroulement fasse polémique. Ce qui l’est, c’est une mise en cause particulièrement lourde : en agissant comme si elles disposaient d’un pouvoir juridictionnel, ces commissions empièteraient sur les droits fondamentaux des personnes concernées. Autrement formulé : en se comportant comme des juges, les parlementaires piétineraient les garanties et franchiraient un seuil inacceptable.
Il s’agira donc d’interroger cette accusation, d’en questionner les limites politiques puis d’esquisser les nécessaires clarifications juridiques qu’un tel mouvement appelle. Car clarifier, encadrer et équilibrer ces mécanismes n’implique ni de brider l’action du Parlement, ni d’amoindrir ses moyens d’investigation, mais bien de réaffirmer que dans une démocratie exigeante, la force du contrôle parlementaire suppose la rigueur des garanties procédurales.
Un arsenal inégal à l’exécution fragile
À l’Assemblée nationale, durant le mandat de Nicolas Sarkozy, seules 6 commissions d’enquête furent constituées. Il y en eut 17 dans la législature de 2012 à 2017. Puis 25 lors du premier mandat d’Emmanuel Macron et 19 entre 2022 et 2024. Depuis le début de l’actuelle législature, au Sénat, depuis 2022, 18 commissions d’enquête ont travaillé.
À mesure que leur rôle s’est intensifié sous le regard du public et des médias6, le cadre normatif dans lequel travaillent les commissions d’enquête s’est brouillé. Il en résulte une incertitude préjudiciable à leur légitimité autant qu’à leur efficacité.
Convocation obligatoire, déposition incertaine
Publiée au JO dans son numéro 82 daté du mardi 24 mars 1914.
Roger Bonnard, « Les pouvoirs judiciaires des commissions d’enquête parlementaire et la loi du 23 mars 1914 », Revue du droit public et de la science politique, 1914, tome 31, p. 386-409.
Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, tome 1, 1902, p. 689.
« Aucune disposition constitutionnelle, légale ou conventionnelle ne prévoit l’immunité ou l’irresponsabilité pénale des membres du cabinet du Président de la République », [en ligne].
Stéphane Mandard, « Scandale des eaux en bouteille : « L’Élysée savait au moins depuis 2022 que Nestlé trichait depuis des années », selon le rapporteur de la commission d’enquête », Le Monde, 7 avril 2025 [en ligne].
Maxime Sirvins, « Relaxe pour deux militants des Soulèvements de la Terre », Politis, 17 janvier 2025 [en ligne].
Pierre Januel, Robin Richardot, « Au Parlement, le regain d’intérêt pour les commissions d’enquête suscite des frictions », Le Monde, 25 mai 2025 [en ligne].
Antoine Armand, Rapport de la commission d’enquête sur la souveraineté énergétique, Assemblée nationale, 1028, tome 3, p. 586 [en ligne].
Pourtant sous la IVe République, Albert Lebrun ancien président de la République, avait été auditionné à cinq reprises en 1948 par la commission chargée d’enquêter sur les événements intervenus en France de 1933 à 1945.
« Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée » dispose l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 organisant leur fonctionnement. Ce pouvoir constitue l’un des deux piliers de l’information parlementaire, au même titre que la faculté d’investigation « sur pièces et sur place » (cf. supra). Son origine remonte à la loi Rochette du 23 mars 19147 qui visait à lever les blocages récurrents en dotant les commissions de pouvoirs quasi juridictionnels8. Il s’agissait alors d’assurer la comparution des témoins et la sincérité de leurs dépositions.
Car c’est bien là que réside le cœur battant de toute commission : dans le témoignage, parole vive qui éclaire, contredit et fait surgir l’impensé. Eugène Pierre affirmait avec raison qu’« il ne saurait y avoir d’investigation sérieuse en l’absence de dépositions orales »9. Sous ce rapport, ce pouvoir de contrainte, s’il repose sur une articulation conforme à l’équilibre des pouvoirs – la prérogative coercitive appartenant à l’autorité judiciaire, seule garante des libertés individuelles selon l’article 66 de la Constitution –, n’en demeure pas moins tributaire, dans sa mise en œuvre, d’un relais judiciaire souvent incertain, ce qui en altère l’effectivité concrète.
Heureusement, la comparution est le plus souvent volontaire : la grande majorité des personnes convoquées par une commission d’enquête s’y soumettent de bonne grâce. Une seule fois dans l’histoire, la contrainte fut mobilisée. Il s’agissait de faire face au refus coordonné des juges consulaires du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan d’être entendus par la commission rapportée par Arnaud Montebourg. À la demande du président François Colcombet, le procureur de la République fit usage de la force publique : les gendarmes de la brigade territoriale délivrèrent dans la matinée du 11 juin 1998 de nouvelles convocations pour l’après-midi aux dix-sept magistrats récalcitrants. Tous se conformèrent alors à la convocation.
Cependant, en dehors de cette exception, le consentement spontané à comparaître ne saurait dissimuler les fragilités pratiques du mécanisme. Il suffit, en réalité, qu’une personnalité convoquée oppose un motif d’ordre politique ou constitutionnel, aussi discutable soit-il, pour que l’audition soit suspendue. Parfois même ajournée, voire annulée. Ce pouvoir de contrainte, pourtant inscrit dans le droit, reste ainsi dépendant de la volonté du convoqué. Ce qui relevait d’une obligation est ainsi devenue peu à peu une possibilité discutable. Et c’est précisément ce décalage entre la lettre du droit et l’effectivité de son application qui fissure, peu à peu, la force symbolique des commissions d’enquête.
En effet, des personnalités convoquées n’hésitent plus à faire obstacle à leur audition en invoquant la spécificité de leurs fonctions. Le cas de l’ancien secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, illustre avec le plus de constance les limites effectives du dispositif : auditionné à plusieurs reprises – notamment en 2018 par la commission sénatoriale sur l’affaire Benalla, puis en 2020 dans le cadre de l’enquête sur les concessions autoroutières – il déclina ensuite successivement plusieurs convocations, devant la commission des finances en février 2025 comme devant la commission Nestlé en mai 2025. Pour justifier ces absences, la même ligne de défense fut invoquée : celle de la séparation des pouvoirs. Or cette argumentation ne résiste pas à un examen sérieux : si le chef de l’État dispose d’une immunité en vertu de l’article 67 de la Constitution, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2012, a clairement établi qu’aucune disposition constitutionnelle n’accordait ce privilège à son entourage10. Il est donc juridiquement incontestable que le secrétaire général, comme tout autre membre du cabinet du Président, est tenu de répondre à une convocation. Rien ne justifie l’extension prétorienne de l’irresponsabilité présidentielle à ses collaborateurs. D’autant que la présidence de la République a transmis à la commission, dans le cadre de ses travaux, plus de soixante-dix pages de notes, courriels et échanges, comme l’a rappelé le sénateur Alexandre Ouizille11. Preuve, s’il en fallait, qu’en réalité, le refus d’Alexis Kohler n’est pas juridique : il est politique.
Le cas de Pierre-Édouard Stérin en est une autre illustration. Homme d’affaires et initiateur du projet politique Périclès, il a décliné à deux reprises, au printemps 2025, les demandes de la commission portant sur l’organisation des élections. Le droit n’a pas changé ; la tolérance implicite face au refus, si. Et c’est ce glissement silencieux qui fragilise la portée juridique de la convocation parlementaire.
Plus préoccupant encore, les rares poursuites engagées à la suite de refus de comparaître n’ont, à ce jour, jamais abouti. Par exemple, en mai 2025, le parquet a classé sans suite le signalement effectué après le refus d’Alexis Kohler. Il est d’ailleurs surprenant que les parlementaires aient accepté sans mot dire, ne décidant pas de relancer leur démarche en ne se portant pas partie civile.
Il est vrai que quelques mois plus tôt, le 17 janvier, le tribunal judiciaire de Paris avait relaxé deux militants des Soulèvements de la Terre poursuivis pour avoir décliné l’invitation d’une commission d’enquête sur les groupuscules violents12. Le juge avait estimé que leur présence aurait pu méconnaître leur droit au silence, dès lors que des poursuites étaient en cours pour des faits connexes13.
Il faut donc bien constater qu’à mesure que ces décisions s’accumulent, l’obligation de comparaître s’émousse. La faculté discrétionnaire a remplacé le devoir légal. La législation demeure intacte, mais sa portée dissuasive décline, faute d’application concrète.
Répondre à cette vulnérabilité n’est pas simple. Déjà en 1977, lors du dernier débat d’ampleur sur les moyens de contrôle des commissions, la proposition d’attribuer au président de la commission le pouvoir de délivrer un mandat d’amener, à l’instar de la loi belge du 3 mai 188014, avait été écartée, par crainte de rompre l’équilibre des pouvoirs.
Plus récemment, le sénateur Ouizille a proposé d’instituer un « référé-vérité », inspiré du référé environnemental, permettant à un juge de contraindre, dans l’urgence, une personne à s’exprimer devant une commission. Mais en confiant toujours la décision au juge, cette piste laisse inchangée la dépendance organique du Parlement à une validation extérieure.
Puisqu’il serait impensable de dessaisir l’autorité judiciaire de sa compétence constitutionnelle, la solution doit être recherchée en amont, dans la consolidation des fondements mêmes des convocations. En exigeant une motivation substantielle (une démonstration rigoureuse de l’intérêt public poursuivi, articulation précise du lien avec les objectifs de l’enquête) et un formalisme renforcé, par exemple sous la forme d’un questionnaire écrit préalable, le Parlement réaffirmerait ainsi que l’audition sollicitée ne relève ni de la convenance ni de l’opportunisme. Elle s’imposerait comme une nécessité démocratique, inscrite dans une méthode.
Ce surcroît d’exigence aurait une vertu réflexive : il découragerait les demandes d’auditions instrumentalisées, les emballements médiatiques et les scénographies partisanes. Car c’est bien le danger d’une certaine dérive contemporaine : à force de banaliser l’usage de ses pouvoirs, la commission affaiblit ce qui en faisait la force.
Proposition n° 1 : Subordonner les convocations à une motivation claire fondée sur un intérêt public avéré, les adosser à un questionnaire préalable formalisant l’objet de l’audition ; instituer un contrôle a posteriori des refus, confié à une tierce autorité (déontologue, Bureau, ou commission ad hoc), pour qualifier les détournements manifestes.
Enfin, par souci de cohérence institutionnelle, il serait opportun de clarifier le régime applicable aux anciens présidents de la République. En mars 2023, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont accepté d’être entendus à l’Assemblée nationale par une commission d’enquête, venue « les interroger sur les orientations énergétiques de leur mandat »15. Ce geste rompait avec la position exprimée par François Mitterrand, qui, en août 1984, avait opposé une fin de non-recevoir à la convocation adressée à Valéry Giscard d’Estaing dans le cadre de l’enquête parlementaire sur l’affaire des « avions renifleurs ». Dans une lettre au président de l’Assemblée, il affirmait alors que « ni la lettre, ni l’esprit, ni la pratique des institutions » n’autorisaient une commission à entendre un ancien chef de l’État, lui conservant donc, au-delà même de l’exercice de ses fonctions, le bénéfice de l’irresponsabilité constitutionnelle16.
La participation volontaire de MM. Sarkozy et Hollande marque une inflexion politique notable. Elle témoigne d’une maturité démocratique qu’il serait judicieux d’inscrire dans le droit. Une évolution inspirée du modèle portugais – où les anciens chefs d’État peuvent, s’ils le souhaitent, témoigner devant les commissions d’enquête, oralement ou par écrit – permettrait de consacrer cette ouverture, sans remise en cause des équilibres républicains.
Proposition n° 2 : Reconnaître aux anciens présidents de la République le droit, s’ils le souhaitent, de témoigner devant une commission parlementaire d’enquête, avec la faculté, s’ils le préfèrent, d’exercer cette prérogative par écrit.
Un précieux pouvoir d’accès aux documents
Cf. l’audition du président-directeur général du groupement U où le président de la commission précise que « l’audition publique se poursuivra à huis clos si les sujets abordés touchent au secret des affaires. La confidentialité de ces échanges sera alors complète », Rapport de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, Assemblée nationale, 2268, tome 2, comptes rendus des auditions, 25 septembre 2019, p. 418 [en ligne].
Sébastien Pietrasanta, Rapport de la commission relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, Assemblée nationale, 3922, 5 juillet 2016 [en ligne].
Rapport de la commission sur le Crédit Lyonnais, Assemblée nationale, 1480, 6 juillet 1994, tome 1, p. 23 [en ligne].
Camille Polloni, « Meurtre de Sarah Halimi : une commission d’enquête dévoyée par son président », Médiapart, 25 novembre 2021 [en ligne].
Philippe Terneyre, « Quelle est l’étendue des informations qu’une personne auditionnée par une commission d’enquête a l’obligation de délivrer ? » in Mélanges en l’honneur d’André Roux, Dalloz, 2022, p. 462 [en ligne].
Philippe Seguin, Rapport de la commission sur le Crédit Lyonnais, Assemblée nationale, 1480, tome 2, p. 39 [en ligne].
Muriel Jourda, Jean-Pierre Sueur, Rapport de la commission sur l’Affaire Benalla, Sénat, 324, 20 février 2019, p. 106 [en ligne].
C’est-à-dire « en application du droit actuellement en vigueur ».
L’accès aux documents constitue l’autre grande source d’information des commissions d’enquête. Aux termes de l’ordonnance de 1958, les rapporteurs sont « habilités à se faire communiquer tout document de service, à l’exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, des affaires étrangères ou de l’autorité judiciaire ». Dans les faits, la protection du secret des affaires a été progressivement ajoutée à cette liste de restrictions par certaines commissions qui le prennent en compte lors de l’organisation des auditions ou de la rédaction de leur rapport17.
En pratique, cette faculté est activement et largement utilisée. Quasiment tous les rapporteurs d’enquête décrivent ces contrôles à l’instar du député Sébastien Pietrasanta, qui soulignait en 2016 s’être « fait communiquer de très nombreuses pièces afin d’être en mesure de traiter avec la plus grande rigueur un sujet aussi sensible que complexe »18. Inversement, rares sont ceux qui, comme François d’Aubert en 1994, écrivait qu’il « ne pouvait que déplorer que durant tout le déroulement de l’enquête, ses demandes d’informations ou de documents adressées au Crédit lyonnais lui-même aient reçu soit une fin de non-recevoir, soit des réponses souvent tardives. »19
Lorsque l’obstacle survient, les rapporteurs privilégient la voie directe : plutôt que de solliciter la Justice, ils actionnent leur droit de contrôle « sur place », misant sur l’effet de surprise qui l’accompagne généralement. Ce choix témoigne d’un pragmatisme fécond : les parlementaires agissent comme s’ils ne nourrissaient aucune attente sur l’activation effective des sanctions pénales prévues par l’ordonnance.
Mais ce qui a récemment changé, c’est le tempo médiatique qui rythme les enquêtes : conférences de presse en cours de mission, publications sur les réseaux sociaux, vidéos commentées par les rapporteurs eux-mêmes… Ce besoin de « scénariser » en temps réel est devenu une constante. La mise en œuvre du pouvoir d’information se double désormais d’une stratégie d’exposition.
Cette évolution appelle une double vigilance. D’abord parce qu’aucune règle juridique ne limite aujourd’hui la communication des présidents ou des rapporteurs avant l’adoption du rapport final. Ensuite parce qu’une prise de parole trop précoce ou trop polémique peut fragiliser la crédibilité même de la commission, en donnant le sentiment d’un verdict rendu avant même la clôture des travaux. Le risque est bien réel : la parole parlementaire, lorsqu’elle précède sa propre formalisation, peut perdre sa légitimité.
Ainsi, en 2021, lorsque Meyer Habib, président de la commission « chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi », publie sur sa page Facebook un résumé de l’audition à huis clos de la partie civile dans la procédure judiciaire, il compromet la confidentialité des travaux en cours. Ce manquement lui vaudra un rappel à l’ordre du président de l’Assemblée nationale. Il n’en tiendra cependant aucun compte, puisqu’il publiera, deux semaines plus tard, sur son compte X, des photos prises sur les lieux du crime, lors d’une visite effectuée en compagnie du frère de la victime20. De même lorsque le rapporteur LFI de la commission Betharram, le 25 juin 2025, soit une semaine avant la publication de son rapport, saisit par courrier la présidente de la commission des affaires culturelles lui demandant d’engager une procédure pour parjure contre le Premier ministre à raison de ses déclarations en audition, il contribue à brouiller les frontières entre instruction collective et initiative individuelle. Ou encore, lorsque le président de la commission sur la TNT, Quentin Bataillon se précipite le 2 avril 2024 sur le plateau de Cyril Hanouna pour critiquer publiquement son propre rapporteur ou le concurrent de ce dernier, Yann Barthès, il nuit lui aussi à la crédibilité du travail parlementaire.
Dans ce contexte, l’instauration d’un devoir de discrétion temporaire pour les présidents et rapporteurs de commission, applicable jusqu’à l’adoption du rapport final, mérite une réflexion approfondie. Sans porter atteinte à la liberté d’expression ni à la publicité des travaux parlementaires, une telle mesure garantirait la sérénité du processus et renforcerait la légitimité de la parole institutionnelle. En d’autres termes : moins parler pour mieux convaincre.
Proposition n° 3 : Instaurer un devoir de discrétion temporaire interdisant toute communication publique portant sur les travaux en cours jusqu’à l’adoption du rapport final, afin de préserver la sérénité des débats et la légitimité de ses conclusions.
La médiatisation croissante des contrôles sur place rend nécessaire la clarification de la notion de « document de service ». L’ordonnance de 1958 n’en propose aucune définition, pas plus que la jurisprudence21. S’agit-il exclusivement des documents émanant des administrations publiques ? Ou plus largement de toutes les pièces relatives à l’organisation et à la gestion des services publics, y compris dans leurs dimensions déléguées ou externalisées ? En l’état, la portée de cette notion reste flottante, laissée à l’appréciation des acteurs concernés et, de fait, des parlementaires eux-mêmes, qui tendent à adopter une interprétation « large de la notion de document de service, comme le fait la Cour des comptes pour les documents de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à son contrôle, et qu’elle peut se faire communiquer en application de l’article 9 de la loi de 1967 »22.
Il arrive aussi que la réticence ne vienne pas des personnes convoquées, mais des institutions elles-mêmes, qui manifestent une forme de prudence excessive, voire artificielle, lorsqu’il s’agit de transmettre certains documents. Dans l’affaire Benalla, les rapporteurs de la commission d’enquête ont ainsi constaté que le ministère de l’Intérieur refusait de communiquer plusieurs pièces clés : la décision du préfet de police accordant un permis de port d’arme à Alexandre Benalla, les avis recueillis à cette occasion, ou encore une note interne relative à sa présence lors de la manifestation du 1er mai. Le motif invoqué tenait à ce que ces documents avaient été saisis par l’autorité judiciaire, ce qui leur conférait, selon le ministère, un lien direct avec le périmètre de l’information judiciaire.
Or les rapporteurs relèvent eux-mêmes que cette justification s’est heurtée à un paradoxe : l’autorité judiciaire, interrogée par la suite, a expressément validé l’accès parlementaire à ces pièces, considérant qu’aucun obstacle constitutionnel ne s’y opposait dès lors que les missions étaient de nature différente23. Ce qui était présenté comme un obstacle juridique relevait donc d’un choix d’interprétation sinon d’un prétexte.
Une situation comparable est survenue lors de l’enquête sénatoriale sur les pratiques de Nestlé. Refusant de transmettre certains documents à la commission, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’est vue contredite par les faits : ces mêmes documents avaient déjà été communiqués à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui n’est pourtant qu’une inspection administrative24. Cette dernière peut donc consulter ce que le représentant de la nation ne peut lire. Ce déséquilibre soulève une question de principe : pourquoi un service administratif disposerait-il d’un accès plus large à des documents que le Parlement dans l’exercice d’un contrôle démocratique ?
Une situation comparable est survenue lors de l’enquête sénatoriale sur les pratiques de Nestlé. Refusant de transmettre certains documents à la commission, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’est vue contredite par les faits : ces mêmes documents avaient déjà été communiqués à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui n’est pourtant qu’une inspection administrative24. Cette dernière peut donc consulter ce que le représentant de la nation ne peut lire. Ce déséquilibre soulève une question de principe : pourquoi un service administratif disposerait-il d’un accès plus large à des documents que le Parlement dans l’exercice d’un contrôle démocratique ?
Ces exemples soulignent une même faiblesse : l’indéfinition de la notion de « document de service » permet, sous couvert d’argumentation juridique, de restreindre l’accès à des informations essentielles. En conséquence, il devient indispensable d’encadrer plus précisément ce périmètre, tant pour garantir l’efficacité du contrôle que pour sécuriser juridiquement les entités sollicitées. Et de ce point de vue, le remède réside peut-être dans la simplicité : en supprimant la qualification « de service » au profit d’un droit d’accès plus direct aux documents administratifs non couverts par un secret protégé. Ce recentrage permettrait de lever les malentendus, d’aligner les pratiques sur celles d’autres corps de contrôle et de réaffirmer le principe selon lequel le Parlement, en matière d’enquête, ne saurait être considéré comme un requérant ordinaire.
Proposition n° 4 : Reconnaitre que « pour l’exercice des missions, le rapporteur a libre accès à tous les documents utiles à l’exception de ceux protégés par un secret ».
Ces précisions de lege ferenda25 seraient utiles mais elles ne concernent pas le cœur des difficultés que pose aujourd’hui le déroulement des commissions d’enquête. La véritable et urgente difficulté à résoudre tient au respect des principes de la CEDH par des structures qui se comportent parfois comme « des juridictions de fait »26.
Témoins piégés, garanties trouées
La place singulière qu’occupent les témoins dans l’enquête parlementaire souffre de multiples fragilités que le législateur ne semble se résigner d’aborder qu’à la marge. La dernière intervention d’ampleur remonte à la loi du 14 novembre 200827 adoptée à la suite d’un constat partagé : les personnes contraintes de témoigner devant une commission ne bénéficiaient pas d’une protection équivalente à celle reconnue aux témoins dans les enceintes juridictionnelles. Ce texte visait à combler cette lacune, en garantissant aux auditionnés une forme d’immunité relative, notamment contre les actions en diffamation fondées sur leurs propos, sous réserve que ceux-ci ne soient pas étrangers à l’objet de l’enquête. Mais cette réforme, si elle a apporté des clarifications utiles, reste insuffisante face à la complexité croissante des auditions, à la pression médiatique qui les accompagne et à l’ambiguïté persistante du statut procédural des personnes entendues.
Un droit à l’avocat ?
Paule Gonzalez, « Quand les commissions tournent parfois au procès public sans droit de la défense », Le Figaro, 23 mai 2025 [en ligne].
Les textes sont silencieux sur un point pourtant sensible : le droit pour une personne auditionnée de se faire accompagner. Rien ne l’interdit, rien ne l’autorise expressément. Ce vide normatif a installé une incertitude durable, où la présence d’un avocat ne relève pas d’un droit opposable, mais d’une tolérance aléatoire des présidences des commissions.
Les pratiques confirment ce flou. Dans les derniers travaux, plusieurs personnes entendues se sont présentées assistées d’un conseil, sans que cela ne soulève d’objection comme lors de l’audition des influenceurs par la commission TikTok en 2025. Dans tous ces cas, cette faculté fut accordée sur appréciation discrétionnaire, non sur la base d’un droit formel. Et certaines scènes en illustrent les limites. Lors de la commission sur l’affaire Sarah Halimi, une magistrate est venue accompagnée de la secrétaire générale de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), pourtant non invitée. Le président accepta d’abord sa présence, à condition stricte de non-communication avec la personne auditionnée, prérequis que les deux intéressées n’ont, selon le rapport, pas respecté28. Conséquence : le président « demanda » à la représentante syndicale de quitter la salle. Curieusement d’ailleurs, le compte rendu invoque un mystérieux « manquement au règlement » sans toutefois préciser l’article concerné. En réalité, il s’agit plus vraisemblablement d’un manquement aux conditions fixées par le président pour cette audition particulière.
Lorsqu’il est admis à assister une personne entendue, l’avocat se voit le plus souvent cantonné à un rôle purement passif, celui d’un spectateur silencieux, qualifié de « taisant »29. Ce cadre incertain ouvre la voie à des pratiques disparates : ici, le conseil demeure en retrait sans intervenir ; là, il souffle discrètement à son client de ne pas répondre, lorsque certaines questions font naître un risque d’auto-incrimination, à l’image de l’audition d’Alexandre Benalla en 2019, au cours de laquelle son avocate s’est exprimée à plusieurs reprises à voix basse, l’incitant à garder le silence sur les points sensibles.
Cette absence de règles précises engendre une insécurité procédurale palpable, y compris pour les praticiens du droit eux-mêmes. Ainsi, Pierre-Olivier Sur, ancien bâtonnier de Paris, confie-t-il avoir recommandé à certains de ses clients – désireux d’être accompagnés devant une commission d’enquête – de ne pas solliciter sa présence, afin de ne pas donner l’apparence qu’ils étaient mis en cause30. Dans un espace d’audition dont les règles sont mouvantes et la perception éminemment politique la présence de l’avocat est abusivement interprétée comme un aveu de culpabilité.
Chez plusieurs de nos voisins, la situation se révèle bien plus claire31. Aux États-Unis, les règlements des deux Chambres reconnaissent explicitement aux personnes entendues par une commission d’enquête le droit d’être accompagnées d’un counsel. Ce dernier n’intervient pas pendant l’audition proprement dite : son rôle se limite à conseiller en amont la personne entendue sur ses droits, dans un cadre distinct de celui du procès. En Italie ou en Belgique, le droit à l’assistance d’un avocat est également reconnu aux témoins auditionnés sous forme libre, dès lors qu’ils en font la demande. Là encore, les prérogatives de l’avocat demeurent restreintes : il peut formuler des conseils, mais n’a ni droit de parole ni faculté d’interrompre l’audition.
Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, sa position demeure hésitante. Dans l’arrêt Montera c. Italie de 2002, la Cour admet que les garanties procédurales de l’article 6 de la Convention, relatives au procès équitable, ne s’appliquent pas pleinement aux commissions parlementaires, en raison du caractère non juridictionnel de leurs travaux et de l’absence de sanctions directes. Mais cette approche a été nuancée par des décisions ultérieures. Ainsi, dans Leemporel et S.A. Ed. Ciné Revue c. Belgique de 2006, la Cour reconnaît que l’assistance confidentielle d’un avocat peut constituer une exigence du droit au procès équitable, dès lors que les déclarations faites devant une commission sont susceptibles d’être utilisées ultérieurement en justice. Le droit à un conseil n’est donc pas exclu, mais il est conditionné aux prérogatives de la commission d’enquête et à la nature des risques encourus par la personne auditionnée.
L’incertitude actuelle crée à nouveau une inégalité entre les personnes auditionnées, nourrit l’arbitraire dans la conduite des auditions et expose les commissions à des critiques croissantes de déloyauté procédurale. Le droit à l’assistance par un conseil ne saurait demeurer une tolérance : il doit devenir une garantie formelle.
Il faut donc inscrire dans les textes le droit pour toute personne entendue d’être assistée, si elle le souhaite, par un avocat, quelle que soit sa qualité. Cela ne suppose ni un alignement sur le cadre judiciaire, ni un affaiblissement de l’autorité parlementaire mais appelle simplement un encadrement équilibré. Sur le modèle de l’article 63-4-3 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue, le rôle de l’avocat pourrait être défini de manière limitée mais effective : présence à l’audition, faculté de demander la reformulation d’une question ambiguë, possibilité de solliciter une brève suspension pour échange confidentiel, et, en fin de séance, dépôt d’observations écrites obligatoirement annexées au compte rendu publié.
En contrepartie, il devrait être précisé que l’avocat ne saurait prendre la parole à la place de la personne auditionnée ni entraver le déroulement régulier de l’audition. Un tel équilibre offrirait un double bénéfice : mieux protéger les personnes entendues et mieux encadrer l’autorité des commissions.
Proposition n° 5 : Reconnaître explicitement le droit pour toute personne auditionnée de se faire assister par un avocat.
Un droit au huis clos ?
Rapport de la commission violence dans le milieu culturel, Assemblée nationale, 1248, 2 avril 2025, p. 945 [en ligne].
Loi nº 5/93, du 1er mars 1993, le Boletín Oficial del Estado (BOE), qui peut être traduit par « Bulletin Officiel de l’État ».
Anaïs Brucher, Roxane Delforge, Marie Nelles, Marc Verdussen, « L’articulation entre l’enquête parlementaire et l’enquête judiciaire », in L’Enquête parlementaire, Larcier Intersentia, 2024, p. 212.
Guy Carcassonne, Pour les commissions d’enquête, Le Point, 1349, 25 juillet 1998.
La publicité des auditions est un principe posé par l’ordonnance de 1958. Il n’est nullement question d’y déroger. Mais les modalités de recours au huis clos, également prévues à l’article 6, méritent d’être interrogées, tant au regard des exigences de l’enquête parlementaire que des garanties attendues par les personnes entendues.
En l’état, le texte se borne à indiquer que les commissions « peuvent décider l’application du secret ». Cette formule laconique ne crée ni obligation de motiver une telle décision, ni droit opposable pour les personnes auditionnées qui en solliciteraient le bénéfice. Aucune condition de fond ni de procédure n’est posée : le huis clos repose, en pratique, sur une liberté d’appréciation quasi totale.
Il convient par ailleurs de ne pas confondre huis clos et secret absolu. Une audition conduite à huis clos n’implique pas nécessairement que son contenu reste confidentiel. De fait, tout comme le bureau de la commission peut décider de restreindre l’accès à une séance, il demeure libre d’en déterminer, a posteriori, le degré de publicité. Le secret n’est donc ni automatique ni durable : il peut être partiellement levé par la publication d’extraits ou d’un compte rendu. Ainsi, la table ronde organisée à huis clos le 10 mars 2025, réunissant Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Pio Marmaï et Jean-Paul Rouve dans le cadre de la commission d’enquête sur les violences dans le secteur culturel, a fait l’objet d’une restitution intégrée au rapport final.
Cette hypothèse est cependant assez rare, dans la majorité des cas, le huis clos ne donne lieu à aucune restitution écrite. Ce silence documentaire complique d’ailleurs l’analyse, d’autant que les rapports s’attardent peu sur les motivations ayant présidé à son recours. Certaines commissions d’enquête exposées, comme celles consacrées à l’affaire Benalla, y voient un levier de protection légitime. D’autres en font un instrument de convenance, activé par défaut, parfois sans justification explicite ni encadrement clair. D’autres encore avancent l’existence de liens institutionnels susceptibles de brider la liberté de parole des auditionnés32, ou encore la notoriété et l’exposition médiatique des personnes concernées33 dont l’image publique pourrait être affectée par leurs déclarations.
À l’inverse, les bénéfices attendus sont bien identifiés : de nombreux rapporteurs observent que les personnes entendues, libérées de la pression médiatique, livrent une parole plus directe, moins corsetée par la prudence ou les impératifs de communication.
Paradoxalement, ces constats plaident précisément pour la reconnaissance formelle d’un tel droit. Là encore, le droit comparé éclaire nos carences : au Portugal, la loi accorde explicitement à toute personne auditionnée le droit de s’opposer à la publicité de la séance, en invoquant « la protection de ses droits fondamentaux »34. En Belgique, sans aller jusqu’à consacrer un droit subjectif au huis clos, la loi impose aux commissions d’enquête de « mettre en balance l’intérêt à une transparence absolue avec la gravité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée »35. Cette exigence de motivation, inscrite dans la règle, garantit une décision proportionnée et assumée.
L’intérêt du huis clos dépasse la seule protection des personnes entendues. Comme le rappelle Guy Carcassonne, il peut s’avérer indispensable à la bonne conduite des enquêtes, en particulier lorsque des procédures judiciaires sont en cours36. Il constitue, dans ce cas, une alternative plus conforme à l’esprit de l’enquête parlementaire que la pratique des « auditions réservées au seul rapporteur »37, souvent critiquée pour son caractère non collégial et peu transparent. Il permet également de lever certaines inhibitions liées à des rapports de subordination, en offrant à des agents publics un espace d’expression plus libre que celui d’une séance publique.
Dès lors, la reconnaissance d’un droit conditionnel au huis clos, à la main des personnes auditionnées, pourrait être envisagée. Elle ne retirerait pas à la commission son pouvoir d’appréciation, mais imposerait un cadre procédural contraint, fondé sur une demande formalisée et une obligation de motivation en cas de refus.
Proposition n° 6 : Reconnaître à toute personne auditionnée la faculté de solliciter le huis clos, en invoquant des motifs liés à la protection de ses droits fondamentaux ou à l’existence de rapports hiérarchiques sensibles.
Un droit au silence ?
Lire notamment Pierre-Jean Marini, Sisyphe et le Parlement, « Considérations sur le cumul des enquêtes parlementaires et judiciaires en France », Les Cahiers Portalis, 9, 2022, et Robin Binsard, « Audition devant la commission d’enquête parlementaire : un résidu de barbarie », Dalloz actualité, 5 mai 2025 [en ligne].
Audition de Muriel Lienau, présidente-directrice générale de Nestlé Waters, Sénat 19 mars 2025 [en ligne].
Audition de Ronan Le Fanic, ancien directeur de Nestlé Waters Vosges, Sénat, 26 mars 2025 [en ligne].
Nicolas Bastuck, « Ce qui cloche avec les commissions d’enquête parlementaires », Le Point, 22 novembre 2024 [en ligne].
Jean-Eric Gicquel, in Jean-François Kerléo (Dir), Règlement de l’Assemblée nationale commenté, LGDJ, 2022, p. 283.
Philippe Biays, Les commissions d’enquête parlementaires, RDP, 1952, p. 461.
Les personnes convoquées devant une commission d’enquête parlementaire sont tenues de comparaître, de prêter serment et de répondre aux questions posées. Tout refus est pénalement sanctionné sur le fondement des articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Cette logique de contrainte induit une coopération forcée avec l’enquête, fût-ce au détriment de l’intérêt personnel de l’auditionné. Un risque d’autant plus certain qu’il est régulier que les personnes concernées ne soient pas précisément averties de la nature exacte des faits sur lesquels elles devront s’expliquer. L’envoi d’un questionnaire préalable est certes courant mais il n’est en rien obligatoire.
Dans de telles conditions, les témoins ne disposent donc d’aucune marge de manœuvre pour préciser tel ou tel point ou apporter des éléments d’information utiles aux travaux parlementaires.
Cette exigence de vérité souffre d’une absence de tempérament : la loi n’offre aucun droit explicite de se taire, y compris lorsque les réponses sollicitées pourraient exposer leur auteur à des poursuites disciplinaires ou pénales ultérieures. Il ne s’agit donc pas d’une simple incitation à la sincérité, mais d’une obligation de parler sous serment, sans égard pour la situation procédurale de l’intéressé. En sus, aucune distinction n’est opérée entre un témoin neutre et une personne susceptible d’être mise en cause, directement ou non, par ses déclarations.
Cette configuration crée un paradoxe saisissant : les commissions d’enquête mobilisent des outils proches de l’instruction judiciaire, sans offrir en retour les garanties que le droit reconnaît aux personnes suspectées dans ce cadre, au premier rang desquelles, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La doctrine, à plusieurs reprises, n’a pas manqué d’alerter sur cette faille structurelle38.
Cette alternative redoutable – parler ou être sanctionné – doit être confrontée avec les exigences posées par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en matière d’auto-incrimination. L’article 6 §1 de la CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de se taire pour ne pas concourir à sa propre condamnation. En effet, selon la Cour « il ne fait aucun doute que, même si l’article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacré par l’article »39. Or cette garantie, reconnue de longue date à l’article 63-1 du Code de procédure pénale pour la garde à vue, ne dispose d’aucun équivalent explicite devant les commissions d’enquête parlementaires.
Au surplus, la jurisprudence de la Cour européenne, et singulièrement l’arrêt Corbet c. France, fait l’objet d’interprétations contraires comme lors de l’audition des dirigeants Nestlé devant le Sénat le 19 mars 2025. Pour le président et le rapporteur, « la personne entendue en commission d’enquête est donc, de fait, protégée : ses propos ne pourront être utilisés contre elle lors d’un procès pénal »40. Mais pour l’ancien directeur de Nestlé Waters Vosges, Ronan Le Fanic, « cette lecture est simpliste.
La CEDH a aussi rappelé à cette occasion qu’il existait une réelle problématique au regard du droit à un procès équitable. La commission a beau insister sur le fait que la justice pénale ne tiendrait pas compte d’éventuels propos auto-incriminants ou qu’elle ne pourrait pas fonder une condamnation exclusivement sur ceux-ci, cette garantie est, à l’évidence, illusoire tant la teneur des déclarations est relayée publiquement. »41
De fait, la Cour admet que des déclarations recueillies sous serment devant une commission parlementaire peuvent être utilisées dans une procédure pénale, à condition qu’elles ne soient pas l’unique fondement de la condamnation. Si elle reconnaît ainsi un contrôle a posteriori de l’usage des propos tenus, elle n’impose pas de garantie procédurale ex ante à celui qui s’expose en déposant. Cependant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné le 14 novembre 2024 que des éléments issus d’une audition soient retirés du dossier pénal, interdisant de fait qu’ils soient utilisés à charge42.
Là encore, le déséquilibre juridique est manifeste puisque les parlementaires bénéficient de l’immunité prévue à l’article 26 de la Constitution, les mettant à l’abri de toute condamnation pour diffamation ou injure, y compris lorsqu’ils interpellent brutalement un témoin ou formulent publiquement des accusations. Ce privilège, justifié par la nécessité de préserver la liberté d’expression parlementaire, soulève néanmoins des interrogations sur l’équité procédurale au sein des commissions d’enquête, où le rapport de parole est asymétrique par construction. Ainsi, d’un côté, le parlementaire peut tout dire et même se taire car il est protégé par l’article 26 de la Constitution, de l’autre, l’auditionné est contraint de parler et ne bénéficie d’aucune protection. Donc l’asymétrie du rapport à la parole n’est pas accidentelle ou contingente mais résulte du droit en vigueur applicable. Autrement dit, elle est inhérente à son fonctionnement.
En l’absence de droit formel au silence, la seule marge de manœuvre de la personne auditionnée réside dans un exercice d’autocensure anticipée, fondé sur sa propre capacité à évaluer les risques juridiques de ses propos, sans assistance juridique garantie, ni notification formelle des droits. Parallèlement, il faut aussi relever que « face à des refus de répondre considérés comme abusifs, la commission est en pratique désarmée »43. Mais aucun juriste ne saurait se satisfaire de cette brèche juridique, aussi bienvenue soit-elle pour l’auditionné.
Il est donc impératif de repenser les garanties offertes aux personnes entendues pour assurer leur exercice dans un cadre loyal et robuste. Cela passe par la reconnaissance explicite d’un droit au silence, limité aux seules questions dont la réponse serait susceptible d’exposer l’intéressé à une sanction pénale ou disciplinaire. Cette consécration ne saurait cependant être interprétée comme une permission de dissimuler ou de tromper. Elle ne protège pas le mensonge, mais vise exclusivement à préserver l’auditionné d’une auto-incrimination, en particulier dans les cas où une procédure judiciaire est en cours. C’est un droit de réserve, non une échappatoire à la vérité. De plus, ce droit ne ferait pas obstacle à la manifestation de la vérité, mais créerait un espace de protection minimale permettant à la personne auditionnée de signaler, en toute transparence, qu’elle ne souhaite pas répondre à une question à raison de son caractère incriminant. Ce refus pourrait être consigné au procès-verbal sans qu’il soit possible d’en tirer, juridiquement ou politiquement, de conséquences péjoratives.
Proposition n° 7 : Reconnaître expressément le droit pour toute personne auditionnée devant une commission d’enquête de ne pas répondre à une question lorsqu’elle estime que sa réponse est susceptible de l’exposer à une sanction pénale ou disciplinaire.
Naturellement, cette évolution pose une question incidente : sa compatibilité avec le serment prévu par l’ordonnance qui engage chaque personne auditionnée à « dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cette formule impose une obligation de sincérité absolue, sous peine de poursuites pour faux témoignage. Or, dans le cas d’espèce, l’introduction d’un droit encadré à ne pas répondre à certaines questions ne permet plus d’interpréter le serment comme une injonction universelle et sans réserve.
En l’état, cela crée un nouveau paradoxe procédural : soit la personne prête serment de dire « toute la vérité », mais se tait à certaines questions, ce qui pourrait être vu comme une entorse au serment, soit elle parle sous contrainte, de peur d’être poursuivie pour avoir omis une information à cause du serment, même si elle encourt une mise en cause pénale à cause de cette parole.
Il s’en déduit donc logiquement que le maintien du serment en l’état est difficilement compatible avec la reconnaissance effective d’un droit au silence, sauf à en redéfinir le périmètre. Une option s’ouvre alors : intégrer dans l’ordonnance une disposition précisant que le droit au silence suspend l’obligation de répondre sans affecter la sincérité du témoignage. Cela renverrait à la pratique initiale de la IIIe République selon laquelle le serment « avait uniquement pour but de rendre la déposition plus solennelle44 ».
Proposition n° 8 : Articuler le serment avec un droit au silence bien délimité, sans le vider de sa substance.
Les conséquences du faux témoignage
Pauline Türk, « Audition de François Bayrou : quels droits et obligations pour les personnes entendues par les commissions d’enquête ? », Le Club des juristes, 14 mai 2025 [en ligne].
Corinne Luquiens, « Quelles sont les obligations des personnes convoquées par une commission d’enquête ? », Le Club des juristes, 17 juin 2025 [en ligne].
Rapport de la commission sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, Assemblée nationale, 3296, 2 septembre 2020 [en ligne].
« L’enquête pour « faux témoignage » contre Didier Lallement, le préfet de police de Paris, et quatre magistrats classée sans suite », Le Monde, 7 avril 2021 [en ligne].
Adrien Sénécat et Maxime Vaudano, « Affaire McKinsey : la justice dédouane un ancien dirigeant du cabinet accusé de ”faux témoignage” devant le Sénat », Le Monde, 22 juillet 2024 [en ligne].
Présentant une volonté délibérée de tromper.
« Le parquet constate que les investigations de la mission d’information ont, de fait, recouvert un champ en grande partie similaire à celui de procédures judiciaires » (…) « Le signalement mettant en cause M. Alexandre Benalla et M. Vincent Crase fera, par conséquent, l’objet d’un nouvel examen à la lumière des éléments qui auront été rassemblés dans le cadre de ces procédures judiciaires lorsque celles-ci seront terminées ».
À la différence des points déjà traités, le faux témoignage commis devant une commission d’enquête constitue une infraction pénale formellement établie. L’article 6, III de l’ordonnance du 17 novembre 195845, combiné aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal, érige en délit le fait de mentir sciemment sous serment au cours d’une audition parlementaire dotée des pouvoirs d’enquête. Le texte établit une analogie explicite entre ces auditions et celles menées devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire. Cette assimilation justifie une transposition des exigences de sincérité du procès pénal à la sphère parlementaire.
Le champ de l’infraction est relativement large. Selon la jurisprudence, le faux témoignage recouvre non seulement l’énoncé d’un fait matériellement inexact, mais aussi la négation délibérée d’un fait avéré ou l’omission volontaire d’un élément significatif. Encore faut-il que la mauvaise foi soit démontrée, l’infraction supposant un élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de tromper la représentation nationale.
Les sanctions encourues sont particulièrement lourdes : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, soit des peines équivalentes à celles prévues pour faux témoignage devant un tribunal correctionnel. Commettre un « parjure » devant une commission d’enquête est donc encore plus lourdement sanctionné que le fait de refuser de se présenter devant elle46.
Le déclenchement des poursuites obéit à une procédure spécifique. Avant la publication du rapport, seul le président de la commission peut saisir le parquet. Une fois le rapport rendu public, cette faculté appartient également au Bureau de l’assemblée intéressée en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale. Ce filtre politique renforce l’aspect institutionnel de la démarche, en conférant à l’assemblée un rôle de gardienne de la sincérité des travaux d’enquête.
Toutefois, si le cadre juridique est solidement établi, sa mise en œuvre apparaît, en pratique, inégale et en vérité finalement peu dissuasive. Ainsi a-t-il fallu attendre 2018 pour que soit prononcée la première condamnation significative, celle du pneumologue de l’AP-HP Michel Aubier, sanctionné à 20 000 euros d’amende pour avoir dissimulé ses liens avec Total lors de son audition par la commission du Sénat sur la pollution de l’air. Et cette décision demeure, à ce jour, l’unique condamnation ferme intervenue sous la Ve République pour mensonge sous serment devant une commission parlementaire.
Pourtant, les signalements ne cessent de se multiplier, portés par une judiciarisation croissante de la vie publique et une médiatisation plus intense des auditions. Si aucune poursuite n’avait été engagée depuis 1958, 16 procédures l’ont été à l’Assemblée nationale depuis deux ans47. Cependant, elles sont systématiquement classées sans suite par les parquets concernés.
Ce fut par exemple le cas en 2021, où le préfet de police de Paris Didier Lallement faisait l’objet d’une démarche d’Ugo Bernalicis, président de la commission d’enquête sur l’indépendance de la Justice48. Or le 7 avril 2021, le parquet de Nanterre estimant que les « infractions n’[étaient] pas caractérisées » classa le dossier49. En 2022, Karim Tadjeddine, dirigeant du cabinet McKinsey, était accusé de fausse déclaration sur la fiscalité de son entreprise. Là encore, l’ambiguïté de ses propos justifia un non-lieu prononcé par la procureure de Paris, Laure Beccuau50.
Depuis, les mises en cause se sont néanmoins multipliées : à l’initiative du Sénat contre le directeur industriel de Nestlé Waters, sur incitation de Sandrine Rousseau présidente de la commission sur les violences en milieu culturel contre le directeur délégué de NRJ, après délibération du Bureau de l’Assemblée contre Aurore Bergé à la suite à ses déclarations devant la commission sur les crèches privées51. Pour certaines, des informations judiciaires sont engagées mais leur issue reste incertaine en raison de la technicité du délit de faux témoignage. Celui-ci exige en effet la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : une intention dolosive52, des faits matériellement inexacts et l’absence de bonne foi. La complexité des auditions, les zones grises entre mémoire imprécise, omission stratégique ou formulation ambiguë, laissent donc une large marge d’appréciation au parquet. En outre, la cohabitation avec des procédures judiciaires nourrit, chez les magistrats, une réserve fondée sur le principe de séparation des pouvoirs, comme l’a illustré sans ambages le communiqué du 27 juin 2019 de Rémy Heitz, alors procureur de Paris53, concernant le signalement de deux protagonistes de l’affaire Benalla, Vincent Crase et Alexandre Benalla.
Dès lors, si les commissions d’enquête peuvent initier des poursuites, l’efficacité dissuasive du dispositif se heurte à une réalité judiciaire fragmentée, où la gravité symbolique du parjure se dissipe dans les incertitudes procédurales.
Cette réalité n’échappe pas aux parlementaires qui ne nourrissent aucun doute sur l’issue judiciaire54. Et si les plus déterminés continuent à dénoncer régulièrement les « faux témoignages » dès la fin d’une audition jugée insatisfaisante, et avant même toute analyse juridique approfondie, c’est avant tout pour rechercher un effet médiatique.
En définitive, le délit de faux témoignage se révèle faiblement dissuasif. Puisqu’il est inconcevable de retirer à l’autorité judiciaire sa compétence exclusive en matière de poursuites, et qu’aucun parlementaire ne revendique ce pouvoir, ce filtre demeure. Peu de critiques sont d’ailleurs formulées contre les décisions de classement. Ce silence collectif tient peut-être lieu d’aveu : celui d’une forme de résignation procédurale. Faut-il s’en satisfaire ? Sans doute. Mais il n’est pas interdit de s’interroger, alors, sur la force réelle du droit.
Un droit de rectification du compte rendu ?
La gestion des comptes rendus d’audition est le dernier aspect procédural à prendre en compte. Conformément à l’article 6 – IV de l’ordonnance du 17 novembre 1958, la personne entendue est « admise à prendre connaissance du compte rendu de ses propos et peut y joindre, le cas échéant, des observations écrites55 ». Des observations mais pas de corrections. Car, au vrai, cette faculté est stérile : la commission reste libre d’ignorer ces observations, et n’est tenue ni d’intégrer ni même de publier puisque le texte se contente d’affirmer : « ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport ». En d’autres termes, la seule trace accessible de l’audition peut rester partielle ou imprécise, sans que la personne concernée ait les moyens d’en rectifier publiquement la portée.
Au surplus, dans sa décision Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France du 16 avril 201056, le Conseil d’État a jugé qu’aucune juridiction n’était compétente pour se prononcer sur le refus d’une commission d’enquête de publier certaines auditions. Il a réaffirmé à cette occasion que les actes se rattachant à l’exercice de la fonction législative, au rang desquels figurent les décisions relatives à la diffusion des travaux d’une commission, échappaient au contrôle du juge administratif, car ils relèvent par nature de la sphère parlementaire protégée par le principe de la séparation des pouvoirs.
Cette dissymétrie soulève derechef un problème évident de lisibilité, de loyauté procédurale et de respect du contradictoire. Aussi pourrait-il être envisagé de renforcer le droit d’observation des personnes auditionnées, en imposant à la commission d’enquête, à tout le moins, de joindre systématiquement les observations écrites aux annexes du rapport final, sauf décision motivée de refus pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité.
Proposition n° 9 : Reconnaître un droit à la publication des observations annexées au compte rendu.
Assurer le suivi de l’enquête
Sur le principe, l’enquête parlementaire participe pleinement de la fonction législative : en scrutant les dysfonctionnements, elle éclaire les angles morts de la norme. Pourtant, ses recommandations débouchent rarement sur une loi adoptée de façon consensuelle. Mais des exceptions existent, et elles méritent d’être soulignées. Ainsi, la loi du 13 juin 2025 « visant à sortir la France du piège du narcotrafic », fruit du travail des sénateurs Jérôme Durain et Étienne Blanc, illustre ce que l’enquête peut produire de mieux : une analyse lucide du passé capable d’ouvrir des voies solides pour l’avenir. Lorsque les défaillances identifiées relèvent du champ législatif, il revient au Parlement de transformer l’alerte en action, en faisant évoluer la loi.
Mais cette logique reste trop peu appliquée. Trop souvent, le suivi des recommandations est abandonné, dilué ou oublié, y compris par les commissions permanentes elles-mêmes. Or ce suivi est une condition essentielle de la crédibilité de l’enquête. Sur ce point, l’exemple suédois offre un éclairage précieux : le Riksdag (parlement monocaméral) dispose d’une structure permanente dédiée à cette tâche, qui contrôle deux fois par an l’état d’avancement des préconisations émises. Un outil de mémoire institutionnelle, qui empêche les rapports de finir dans les archives.
Proposition n° 10 : Création d’un dispositif de suivi parlementaire des recommandations issues des commissions d’enquête.
Suppression de l’irrecevabilité judiciaire ?
CEDH, 18 février 2016, Arrêt Rywin c. Pologne, § 190-199. La « Commission européenne pour la démocratie par le droit », plus classiquement présentée comme la « Commission de Venise », est l’organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions constitutionnelles.
Une grande part des ambiguïtés actuelles tient au fait que les commissions d’enquête empruntent à la Justice ses codes : audition sous serment, menaces de poursuites pour faux témoignage, mise en scène de la vérité à la barre. Ce mimétisme brouille leur identité, nourrissant le soupçon d’un empiètement sur le domaine réservé du juge, quand bien même leurs finalités seraient distinctes. Dès lors, c’est moins le principe d’intervention parlementaire que le flou de ses méthodes qui alimente la confusion.
Mais ce frein est largement théorique. De nombreuses commissions se sont aventurées, avec plus ou moins de tact, sur des terrains judiciairement sensibles sans qu’un conflit majeur n’éclate. Pourquoi alors maintenir une fiction procédurale fondée sur une séparation artificiellement rigide ? Les expériences étrangères – Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Autriche – montrent qu’une coexistence est non seulement possible, mais surtout constructive. Le juge cherche des responsabilités ; le Parlement, des dysfonctionnements. Vouloir à tout prix éviter l’interférence, c’est, paradoxalement, entraver la complémentarité. C’est priver le législateur de sa capacité à poser un diagnostic public sur une affaire qui bouleverse l’État, au moment même où la société attend de lui une réponse politique.
D’ailleurs, dans son arrêt Rywin c. Pologne du 18 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme, s’appuyant notamment sur les observations de la Commission de Venise57, admet la possibilité d’un concours entre enquête parlementaire et procédure judiciaire, dès lors que les finalités poursuivies par chacune sont distinctes. La Cour souligne ainsi que la coexistence des deux démarches ne constitue pas en soi une atteinte au droit à un procès équitable, à condition que les garanties procédurales soient respectées et que l’indépendance du juge ne soit pas compromise.
Cette perspective n’est pas vraiment nouvelle. Elle fut défendue dès 2008 par Guy Carcassonne puis reprise par le comité Balladur lors des travaux préparatoires à la révision constitutionnelle. En 2017, Jean-Noël Barrot, alors rapporteur d’un groupe de travail sur les moyens de contrôle et d’évaluation, s’y ralliait également. Il précisait : « Il ne s’agit pas de permettre au Parlement d’interférer dans une procédure judiciaire, et encore moins de se substituer à l’autorité judiciaire, mais bien de l’autoriser, et à travers lui les citoyens, à s’informer sur des faits qui auraient suscité une grande émotion dans l’opinion publique. »58
La mise en œuvre de cette orientation supposerait évidemment une révision constitutionnelle. Elle pourrait prendre la forme de la création d’un article 51-2 ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d’information, y compris sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires. » Cette rédaction consacrerait explicitement la possibilité d’enquêtes parlementaires parallèles, tout en renvoyant à la loi le soin d’en fixer les garde-fous.
Proposition n° 11 : Intégrer un article 51-2 nouveau dans la Constitution pour mettre fin à l’interdiction de principe frappant les commission d’enquête lorsque des poursuites judiciaires sont en cours.
Mais concomitamment, il conviendra d’instaurer un mécanisme d’arbitrage constitutionnel préventif. Inspiré de certaines pratiques comparées (notamment espagnoles), ce dispositif conférerait au Conseil constitutionnel la faculté de trancher les conflits d’attribution, sur saisine de l’autorité judiciaire ou de l’une des assemblées parlementaires. Il reviendrait alors au Conseil, saisi en urgence, de décider si les travaux d’une commission empiètent réellement sur une procédure judiciaire en cours, ou si cette dernière compromet l’exercice du contrôle parlementaire. Ce mécanisme offrirait, pour la première fois, une issue juridictionnelle à un dilemme républicain que, le cas échéant, l’hypocrisie procédurale ne suffit plus à contenir.
Il pourrait prendre la forme d’un article 61-2 ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi par l’une des deux assemblées parlementaires ou par l’autorité judiciaire d’un conflit de compétence résultant de l’interférence alléguée entre, d’une part, les travaux d’une commission d’enquête parlementaire, et d’autre part, une procédure judiciaire en cours. Il statue dans un délai de huit jours sur la compatibilité de ces investigations avec les exigences respectives du principe de séparation des pouvoirs, du droit à un procès équitable et de l’exercice du contrôle parlementaire. Sa décision s’impose aux autorités saisissantes et à toute autre autorité concernée. Une loi organique fixe les modalités de cette procédure. »
Proposition n° 12 : Créer un mécanisme de règlement des conflits de compétences entre le Parlement et l’autorité judiciaire confié au Conseil constitutionnel.
Conclusion
Joseph Barthélémy, Précis de droit constitutionnel, Dalloz, 1932, p. 355.
Les commissions d’enquête parlementaire constituent l’un des outils les plus puissants du contrôle démocratique. Elles permettent de forcer le réel à parler, de remuer l’inertie administrative, de rétablir des équilibres politiques altérés. Leur autorité, leur visibilité, leur intensité d’examen en font un levier rare, parfois décisif. Mais cette force est aussi leur fragilité : à être trop souvent convoquées, les commissions d’enquête s’abîment dans la routine et finissent par perdre ce qui faisait leur efficacité : l’exceptionnalité de leur recours.
L’envolée récente de leur nombre, sans hiérarchisation ni stratégie politique d’ensemble, confine à la banalisation. Et dans cette inflation, le spectaculaire prend souvent le pas sur le substantiel. Or ce ne sont pas nécessairement les commissions les plus médiatiques qui produisent des réformes durables, comme l’a illustré de façon éloquente la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias : malgré des auditions spectaculaires de grands patrons, la confrontation n’a pas eu lieu, les réponses sont restées elliptiques, et la suite institutionnelle, incertaine. À l’inverse, certaines commissions moins exposées ont amplement prouvé leur utilité : le travail rigoureux conduit par la députée (PS) Isabelle Santiago sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a permis de fédérer associations et gouvernement autour de mesures concrètes, dans un précieux moment de concorde parlementaire.
Ces contrastes rappellent que la dimension dramatique d’une commission peut faire pression sur l’exécutif, à condition qu’elle serve une stratégie d’éclairage rigoureuse. Mais cette puissance symbolique ne doit pas faire perdre de vue une exigence cardinale : la subsidiarité. Une commission d’enquête n’a de sens que lorsqu’aucun autre moyen d’information (audition en commission permanente, mission d’évaluation, question écrite ou orale) ne permet d’obtenir les éléments nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire. À titre d’exemple, pourquoi créer une commission d’enquête « sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins », comme l’a décidé la commission des lois à l’initiative du député (GDR) Davy Rimane le 5 juin 2025 ? Une mission d’information commune à la commission des lois et à la délégation aux outre-mer de l’Assemblée n’aurait-elle pas été suffisante ? Faire de la commission d’enquête un réflexe procédural, un outil de visibilité ou un simple marqueur d’indignation, c’est appauvrir son contenu et, au fond, trahir sa finalité.
En 1932 déjà, Joseph Barthélémy posait cet avertissement resté intact : « L’enquête parlementaire est à employer rarement. Elle est un instrument de turbulence, de scandale et de désordre. Elle est souvent stérile. »59 À force d’être invoquée pour tout, elle pourrait ne plus servir à rien.


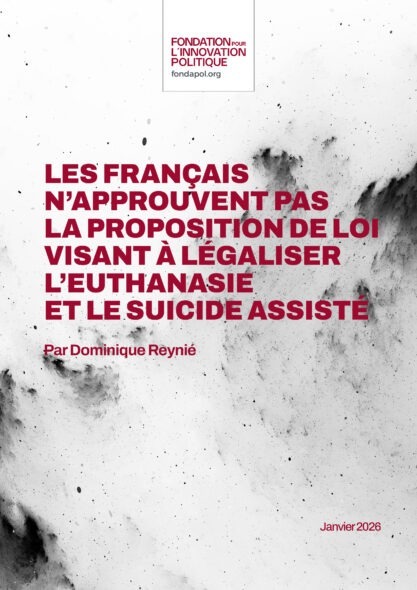









Aucun commentaire.