Va-t-on légaliser la mort provoquée ? Le handicap face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté
Introduction
Les progrès réalisés dans le domaine du handicap
La dimension juridique
La compensation
L’accessibilité au cœur des problématiques
Quelques préconisations d’amélioration
Entre théorie et pratique, le fossé se creuse
La scolarité comme enjeu phare
Être handicapé en France : un combat permanent
Une involution inquiétante : le handicap confronté à la reconnaissance d’un droit à la mort provoquée
Des silences surprenants aux exclusions dangereuses
Une protection insuffisante
L’inquiétude du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH)
Conclusion
Résumé
Une loi sur l’euthanasie et le suicide assisté constituerait une redoutable pression sociale et psychologique pour les 12 millions de Français en situation de handicap. Déjà quotidiennement confrontés à des problèmes d’accessibilité et à d’innombrables difficultés matérielles, ils devront faire face à une société qui rendrait désormais leur mort provoquée plus accessible que les soins et les aides qui leur sont dues. Comme l’illustre le Canada, depuis la loi du 17 mars 2021, les organismes médico-sociaux se trouveraient progressivement enclins à suggérer une « aide à mourir » aux personnes en situation de handicap qui attendent une aide à vivre.
En effet, dans la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, actuellement en discussion au Sénat, les personnes handicapées se verront éligibles à la mort provoquée, au regard du critère « d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée » (article 4, sous-section 2 de la proposition de loi). De surcroît, aucune protection spécifique n’est envisagée, même dans les situations de déficience intellectuelle. Particulièrement vulnérables, les personnes en situation de handicap pourraient se trouver menacées par une loi conduisant le corps médical à donner la mort.
Dans son rapport du 26 août 2025, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a fait part de ses fortes réserves sur le texte en discussion, texte dans lequel il voit « une orientation eugénique claire qui reflète un capacitisme profondément ancré [en France], [découlant] d’un modèle médical dans lequel le handicap est considéré comme une « maladie sociale dont le traitement ne peut conduire qu’à l’éradication de la source de la maladie, c’est-à-dire les personnes handicapées elles-mêmes »». Il demande au législateur français de respecter la convention internationale des droits des personnes handicapées et l’invite à répondre à leurs attentes en termes de prestations, d’aides et de dispositifs spécifiques.
Agathe Barrois,
Normalienne en lettres classiques
Aline Cheynet de Beaupré,
Professeur de droit

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La psychiatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Va-t-on légaliser la mort provoquée ? La gériatrie face au risque de l'euthanasie et du suicide assisté

Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie
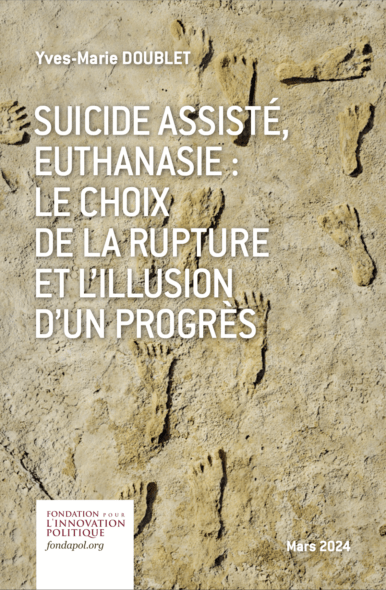
Suicide assisté, euthanasie : le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès
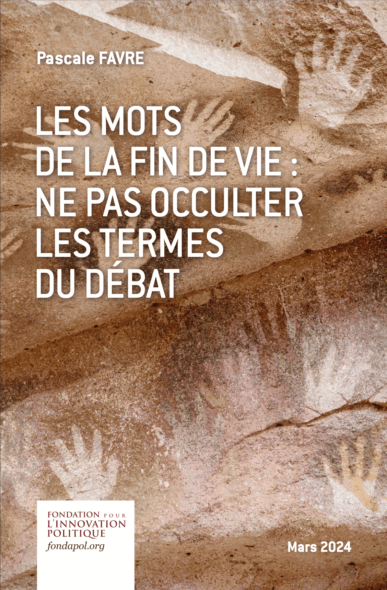
Les mots de la fin de vie : ne pas occulter les termes du débat
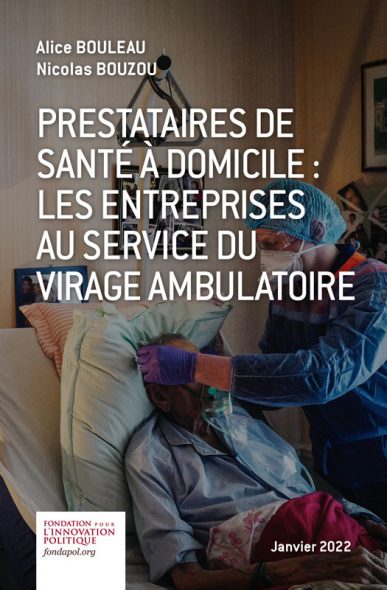
Prestataires de santé à domicile : les entreprises au service du virage ambulatoire
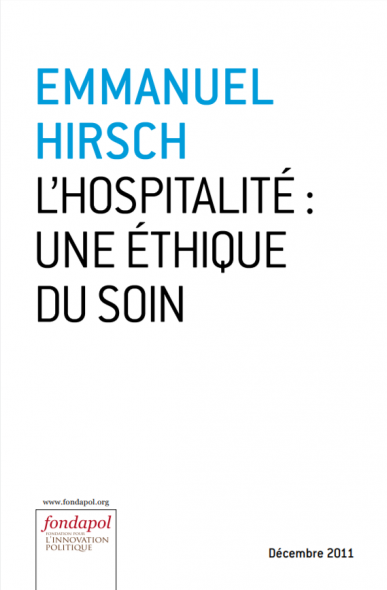
L’hospitalité : une éthique du soin
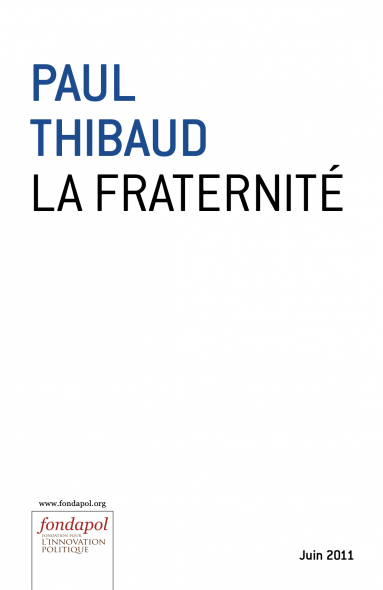
La fraternité
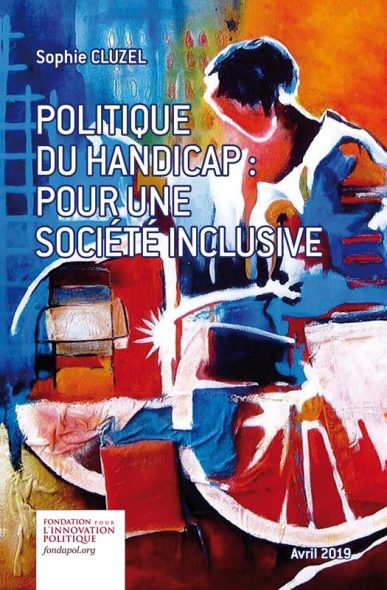
Politique du handicap : pour une société inclusive
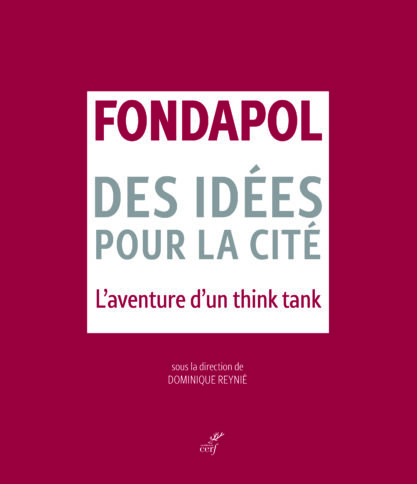
Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank
Introduction
La coordination des trois notes Va-t-on légaliser la mort provoquée a été assurée par Pascale FAVRE et Yves-Marie DOUBLET.
CNCDH, « Handicap : la France condamnée par le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe », 27 avril 2023 [en ligne].
La Drees précise en effet : « En 2019, 7 millions de personnes de 15 ans ou plus déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive et 4,9 millions déclarent être fortement restreintes dans des activités habituelles, en raison d’un problème de santé. Au total, selon le critère ou le croisement de critères utilisé, le nombre de personnes handicapées peut varier de 2,8 millions à 9 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant hors institution, en 2019 » [en ligne].
Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission sur l’évaluation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n° 1692, présenté par Christine Le Nabour et Sébastien Peytavie, déposé le mercredi 9 juillet 2025 [en ligne].
On définit une société validiste ainsi : système considérant les personnes valides comme la norme sociale. Par extension, discrimination envers les personnes en situation de handicap ou simplement vieillissantes.
ONU, « Une économie obsédée par la croissance crée une “crise de santé mentale invisible” pour les personnes en situation de pauvreté », 25 octobre 2024 [en ligne].
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Communiqué de presse, « Crise de la psychiatrie : l’urgence nationale », 27 janvier 2025 [en ligne].
Ordre national des infirmiers, « Étude exclusive sur les Français, le « système de santé de l’évolution de la profession infirmière » : 85% des Français sont favorables à une meilleure reconnaissance et un élargissement des compétences des infirmiers pour améliorer l’accès aux soins », 17 octobre 2024 [en ligne].
Voir notamment le Collectif Santé en danger [en ligne] ; et l’article de Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Système de soins en crise : “C’est terriblement dangereux, pour les soignants comme pour les patients” », Le Monde, 24 janvier 2024 [en ligne, par abonnement].
CNews, « Patient en ALD : voici ce qui pourrait radicalement changer pour le remboursement de vos dépenses de santé », 25 juin 2025 [en ligne].
Lettre Trésor-Éco numéro 145, « Quel avenir pour le dispositif de prise en charge des affections de longue durée (ALD) ? », avril 2015 [en ligne].
Renan Mégy, « Grève des taxis : comment mieux financer le transport sanitaire », Le Point, 3 juin 2025 [en ligne].
Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025 [en ligne].
Les rapporteurs Christine Le Nabour et Sébastien Peytavie, Rapport d’information, op. cit. [en ligne].
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [en ligne].
Le service PAM – Pour Aider à la Mobilité – est un service public de transport à la demande. Créé en 2002, ce service de transport spécialisé a pour but de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.
Cotorep : Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, devenue en 2006 la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), par fusion avec la CDES (Commission départementale de l’éducation spéciale).
Brigitte Klinkert, Question écrite n° 7611 : Pour une République inclusive, 17 juin 2025 [en ligne].
Quatrième commission mixte de l’accord franco-wallon, chiffres du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, décembre 2019 [en ligne].
Yves Détraigne, Question écrite sénatoriale n°01941, 28 juillet 2022 : « En 2022, dix ans après que l’autisme a été décrété “grande cause nationale”, le quotidien des familles reste inchangé et les revendications restent les mêmes au fil des ans : mettre fin à la psychiatrisation des personnes autistes et aux prises en charge inadaptées, exiger la scolarisation effective des enfants autistes dans l’école de la République, développer des établissements d’accueil d’excellence, stimuler davantage la recherche ou encore améliorer le dépistage et le diagnostic précoces des personnes » [en ligne].
HAS et ANESM, Recommandation de bonne pratique, « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », mars 2012 [en ligne].
Au lendemain des Jeux paralympiques de Paris 2024, que reste-t-il de l’engouement national ? La flamme semble réellement soufflée et le bel élan retombé. Mais les premiers signes de cette déception n’étaient-ils pas déjà présents lors des Jeux ? Malgré des efforts de temps d’antennes pour le paralympisme, quelques héros aux beaux sourires médiatisés, la flamme était allumée sur des brindilles bien légères. Des efforts d’inclusion ont suivi, entraînés par de rares Théo Curin propulsés animateurs ou quelques reportages, mais malgré tout, l’indifférence, l’oubli, l’évitement et la malveillance perdurent. Dans le rapport d’activité de l’année des Jeux olympiques, le Défenseur des droits constate que le handicap constitue toujours le premier critère de saisine de cette institution. Il représente 22% des réclamations pour discrimination1. Le 17 avril 2023, le Comité européen des droits sociaux avait considéré que la France avait violé plusieurs articles de la Charte sociale européenne, au regard des droits des personnes handicapées2.
Cette méconnaissance des droits des handicapés est d’autant plus préoccupante que « le nombre de personnes en situation de handicap en France est compris entre 6 et 12 millions3 ». Parmi celles-ci, 80% seraient porteuses d’un handicap invisible. Les déficiences motrices, légères ou sévères, toucheraient plus de 8 millions de personnes. On recense 1,5 million de personnes déficientes visuelles et 6 millions de personnes sourdes et malentendantes. « 700.000 personnes seraient porteuses d’un handicap mental ou cognitif […]. La maladie mentale et les troubles psychiques touchent environ 13 millions de Français dont 3 millions de personnes qui subissent des troubles psychiques sévères4 ».
Notre société est validiste et capacitiste, pour reprendre un vocabulaire que la majorité de la population ne connaît d’ailleurs pas. L’inclusion est de notoriété publique mais demeure un objectif très aléatoire5.
Le rejet, sur les réseaux sociaux, des personnes en situation de handicap reste une réalité quotidienne. L’expression de la haine, notamment, peut inhiber certaines personnes visées, allant jusqu’à les réduire au silence et entraver leur prise de parole dans l’espace public. Le numérique est à peu près accessible à tous. Chacun peut, s’il le veut, publier, créer un compte, mais encore faut-il déjà disposer des outils adaptés. Les zones blanches de l’accès à internet ont été couvertes par les opérateurs, mais les zones blanches de l’outil adapté, disponible et accessible financièrement, subsistent souvent pour les personnes en situation de handicap. Face à ces discours de haine à l’égard du handicap, les moyens gouvernementaux sont inexistants, contrairement à ceux qui sont développés pour lutter contre d’autres problèmes publics. Ainsi, des posts dénonçant le refus par une entreprise, privée comme publique, de laisser entrer un chien guide d’aveugle, ou encore la difficulté pour une personne porteuse de prothèse d’accéder à une animation et recevant par la suite des messages de soutien indignés. Les messages méprisants ou inappropriés sont tout aussi présents.
Le pictogramme du handicap apprend aussi beaucoup de ce monde inconnu et souvent fui. Le handicap invisible est ignoré. Quelques campagnes dans le monde du travail invitent occasionnellement les salariés à se manifester pour faire valoir leurs droits, mais la timidité et la crainte dominent. Dans la vie quotidienne, des justiciers défendent parfois une place réservée aux personnes handicapées contre une occupation injustifiée mais s’indignent souvent contre un porteur de handicap invisible qui peine à se faire reconnaître comme tel.
Maladresse, ignorance, fuite, gêne, voire rejet freinent de façon structurelle des efforts qui manquent d’une réelle volonté d’action et de moyens.
Une lecture pessimiste de cette situation s’inquiétera aussi de la dimension financière de la politique publique qui en découle. Au regard de l’état de nos finances publiques et de l’Assurance maladie, la santé publique doit-elle constituer une variable d’ajustement ? L’accès aux soins en France semble être en parfaite corrélation avec la dégradation du système de santé, et cette situation ne devrait pas connaître d’amélioration compte tenu de l’absence de mesures prises pour y remédier. Cela est particulièrement vrai de la santé mentale. Si l’ONU considère que celle-ci est en difficulté depuis quelques années6, la France a quant à elle fait de la psychiatrie la cause nationale7. Tout comme les médecins, l’Ordre national des infirmiers a alerté l’opinion publique sur cette dégradation8. Les déserts médicaux, les fermetures de lits faute de personnel médical, les agressions de soignants, les manques de moyens et de personnel sont dénoncés de toutes parts9. Les personnes en situation de handicap sont particulièrement sensibles à cette situation en raison d’une vulnérabilité les exposant plus facilement à des problèmes de santé. Face à l’accroissement des dépenses de l’Assurance maladie, une gradation dans la prise en charge des affections de longue durée (ALD) est envisagée. Les patients en phase de rémission de certaines pathologies pourraient ne plus être éligibles à l’exonération des dépenses engendrées par leur maladie. Ils ne retrouveraient ces droits qu’en cas de rechute ou d’aggravation10. Latente depuis au moins 201511, cette question revêt plus d’acuité dans le contexte financier actuel. Dans le sillage des ALD, les véhicules sanitaires légers (VSL) sont affectés. Devenus acteurs incontournables de la santé publique de proximité, les taxis assurent la moitié des déplacements sanitaires. En trente ans, leur activité a triplé, pour un coût de 3,1 milliards d’euros12. Ces économies budgétaires envisagées en matière de santé constituent nécessairement une source d’inquiétude. Les personnes en situation de handicap étant majoritairement plus sujettes à des problèmes de santé, elles subiront ces restrictions par extension de façon inévitable.
Déceptions, incohérences, confusions et désordres semblent être des faits généralisés sur la question du handicap. La scène politique reflète sans surprise cet état. Alors que le Sénat, sensibilisé par le sénateur de la Drôme Gilbert Bouchet, a voté à l’unanimité une prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), les députés ont adopté en première lecture le 27 mai 2025 une proposition de loi envisageant l’euthanasie et le suicide assisté13, et ce sur un fond médiatique projetant la SLA comme « bénéficiaire » d’un tel texte.
Encore ne s’agit-il pas d’une question « politique » opposant deux assemblées parlementaires aux sensibilités diverses et parfois opposées. La confusion ou l’incohérence prévalent. C’est ainsi que l’Assemblée nationale a voté ce dernier texte sans auditionner de personnes en situation de handicap, hormis le Collectif Handicaps, et sans citer une seule fois le mot « handicap » dans la proposition, alors même qu’était rendu public un rapport critique14, rédigé par deux députés, Christine Le Nabour et Sébastien Peytavie, à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 200515 dénonçant de graves insuffisances en matière de handicap.
Certes, depuis plusieurs dizaines d’années, on observe une évolution encourageante de la situation globale et de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap en France, quand bien même le chemin ne serait pas linéaire. Les efforts législatifs portent des fruits et révèlent des avancées notables en matière d’accessibilité, de prise en charge, d’insertion professionnelle et sociale. L’inclusion a progressé. Pourtant, le bilan global n’est pas pleinement satisfaisant. Ces avancées semblent se heurter de façon structurelle à une société validiste et capacitiste qui ne pense le handicap que de façon ponctuelle, face à des sollicitations isolées et conjoncturelles. Les résistances sont fortes et bloquent toute amélioration ou simple application des règles adoptées.
La mobilité des personnes est, pour le handicap moteur, un point névralgique essentiel pour la vie quotidienne et la participation à la vie de la cité. Les PAM16 sont dénoncés. Mais se dégage souvent l’impression que la perception du handicap, par la population ou les autorités, se réduit au « fauteuil ». Or les handicaps sont très majoritairement invisibles. Le handicap mental n’est hélas pas en reste. Les parents des jeunes porteurs de handicap luttent pour obtenir la scolarisation la plus « normale » possible ainsi qu’une prise en charge de leur enfant. Les auxiliaires de vie (AESH), en nombre insuffisant, sont souvent trop peu formés ou bien limités dans le temps accordé par les institutions.
Dans la phase de l’âge adulte, le tableau n’est pas plus encourageant. Les places en établissements sont rares et les bénéficiaires s’y accrochent malgré des contextes parfois difficiles. Les MDPH (maisons départementales pour les personnes handicapées) souffrent de manques de personnels et de moyens. Les acronymes se suivent (par exemple, Cotorep17 avant 2005), mais les problèmes demeurent ou s’aggravent.
Des alternatives sont proposées pour que ces adultes soient accueillis dans des familles quand les proches ne peuvent les prendre en charge toute la journée. Mais ces familles peu nombreuses sont très recherchées. On retrouve les difficultés rencontrées par l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour l’hébergement des mineurs face au déficit de familles d’accueil. Ces similitudes laissent penser que le problème n’est pas seulement lié au handicap mais s’avère plutôt structurel, aussi bien financier que social.
Des différences de traitement en matière de prestation de compensation du handicap subsistent si le handicap apparaît avant ou après 60 ans, contrairement à l’article 13 de la loi de 2005. L’accès à la scolarisation des enfants handicapés et à l’insertion professionnelle connaît des obstacles chroniques, comme le souligne par exemple la députée Brigitte Klinkert18.
La fragilité de notre organisation transparaît encore à travers la pérennisation des accords franco-wallons pour la prise en charge des personnes atteintes de handicap mental. Ces accords, qui remontent à 2005, visaient à pallier une carence de notre système, mais ils n’avaient pas vocation à s’inscrire dans la durée. Ils sont pourtant toujours en vigueur en 2025 et concernent près de 8.000 personnes (7.892 personnes de nationalité française dans les services wallons, dont 6.457 adultes et 1.435 jeunes, en 201819).
De plus, l’effectivité des priorités affichées n’est pas toujours au rendez-vous. Ainsi, après l’annonce déçue20 d’un autisme déclaré grande cause nationale en 2012, suivie de recommandations de bonnes pratiques pour son diagnostic et sa prise en charge21 par la Haute autorité de santé (HAS), le remboursement des fauteuils roulants22, annoncé par le président de la République en 2023, est source de désenchantement. Tous devaient être pris en charge à 100% par la Sécurité sociale sur prescription médicale à compter du 1er décembre 2025. Cet espoir rassurait face aux montants actuellement remboursés : près de 500 euros pour un fauteuil manuel (le coût moyen avoisinant 2.000 euros) et 2.600 euros pour un fauteuil électrique (pour un coût moyen de 8.000 euros). Cependant, les listes de fauteuils « éligibles » pour prétendre à un remboursement intégral reviennent à exclure des fauteuils ne remplissant pas les critères. Ainsi les fauteuils de douche sont-ils écartés de l’opération. Cet exemple, qui peut sembler un détail, résume une grande partie de la question.
En dépit de la liesse admirative suscitée par les Jeux paralympiques de 2024, le handicap n’est désormais plus au cœur des préoccupations. Dans la proposition de loi sur la mort provoquée, comme à chaque annonce de restriction budgétaire en matière de santé, les personnes vulnérables sont les grandes absentes dans les débats.
« Si j’étais toi, je me suiciderais » ou « Tu n’as jamais voulu te suicider ? » ne constituent pas des messages isolés. De nombreuses personnes en situation de handicap établissent, à regret, un lien entre ces commentaires et les répercussions que la loi introduisant l’euthanasie et le suicide assisté provoquerait. Les témoignages des personnes en situation de handicap sont si nombreux qu’on ne devrait ignorer ces messages sociaux, constituant de véritables signaux d’avertissement sur les lendemains d’une loi légalisant l’euthanasie ou le suicide assisté.
Il en résulte des difficultés à conjuguer la progression de l’inclusion avec la protection nécessaire aux personnes en situation de handicap, une forme de normalisation et une attention particulière à la vulnérabilité. Jusqu’où doit-on protéger et comment le faire afin de ne pas stigmatiser ?
Une impression inquiétante se dégage de prétendues avancées qui ne procéderaient pas de deux pas en avant, un pas en arrière, mais plutôt d’un pas en avant, deux pas en arrière.
Les notables progrès constatés ces dernières années (I) autorisent toujours des suggestions d’amélioration (II), mais dans ce mouvement d’évolution positive, la proposition de loi sur la fin de vie laisse craindre que ne s’anéantissent les acquis obtenus (III).
Les progrès réalisés dans le domaine du handicap
« C’est l’injustice qui la première met en mouvement la pensée »23. Sans doute cette réflexion du philosophe Paul Ricœur, qui estime que « le sens de l’injustice n’est pas seulement plus poignant, mais aussi plus perspicace que le sens de la justice »24, est-elle une fine analyse des dynamiques à l’origine des récentes évolutions concernant le handicap et sa prise en charge. Ces dernières années ont permis de prendre conscience des inégalités criantes entre personnes valides et personnes handicapées.
Les avancées que l’on peut observer depuis environ vingt ans en France sont notables. Elles s’inscrivent sur trois plans principaux : à une dimension purement juridique (1), s’ajoute une approche renvoyant à la solidarité collective, dite de la « compensation » (2), sans oublier l’angle, pratique et matériel, de « l’accessibilité » (3).
La dimension juridique
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [en ligne].
Ibid., article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
C’est d’ailleurs le point e) du préambule de la CIDPH, Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
L’Insee et la Drees utilisent ainsi l’indicateur GALI (Global Activity Limitation Indicator ou indicateur de restriction d’activité générale) dont l’un des critères est temporel : il faut être fortement limité, depuis au moins 6 mois et pour un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement.
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ibid., article 64.
Ordonnance n°2021-1554 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la Sécurité sociale relative à l’autonomie du 1er décembre 2021 [en ligne]. On remarquera que si, symboliquement, elle gagne par conséquent un statut équivalent à celui de la maladie, des accidents du travail, de la famille, de la retraite ou du recouvrement, elle ne sert toutefois aucune prestation directe ni n’est en lien avec ses assurés.
La loi de 200525, mal connue du grand public, a constitué un tournant essentiel car elle a donné une définition générale et unifiée du handicap26 pour la première fois en France, et a insisté sur la nécessaire intégration des personnes en situation de handicap dans la vie collective. Le handicap n’est donc plus seulement un défi individuel mais bien collectif, dont le poids doit être réparti entre la personne handicapée et la société, et non plus sur la seule personne en situation de handicap27. L’objectif est ainsi d’atténuer les conséquences du handicap davantage que le handicap lui-même, puisqu’il est sinon définitif, au moins durable28.
Cette loi était structurée autour de deux orientations. L’une portait sur la prévention, la recherche et l’accès aux soins, avec notamment la création d’un Observatoire national du handicap, pour coordonner la recherche et l’innovation, ainsi que la formation des professionnels de santé sur le handicap. L’autre prévoyait la garantie de compensation des conséquences du handicap, consistant en la « réponse à ses besoins29 », allant de « l’accueil de la petite enfance » à « l’offre de service », en passant par la scolarisation et l’insertion professionnelle, le tout visant au « plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie ». De cette compensation devait s’ensuivre la création de la PCH (prestation de compensation du handicap), versée par le département et celle de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) comme garantie de ressources, éventuellement complétée par la MVA (majoration pour la vie autonome). L’accessibilité découlait également de cette logique et devait s’inscrire dans l’étude de différents aspects de la scolarité, de l’emploi, des dispositions architecturales et équipements des bâtiments publics et des animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées. Furent enfin créées les MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) qui « exerce[nt] une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap30». L’ensemble, plutôt complet, laissait espérer une nette amélioration de la vie des personne handicapées et de leur inclusion dans la société française.
Deux autres évolutions juridiques ont vu le jour après 2005, à savoir la création d’une nouvelle branche du régime général de la Sécurité sociale consacrée à l’autonomie31, et surtout la ratification de la CIDPH (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées), entrée en vigueur en 201032, promettant un alignement du droit français sur le droit international. Si cette convention n’a pas vocation à créer de nouveaux droits, elle vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine jouissance des droits humains pour les personnes handicapées. Elle garantit aussi l’égalité devant la loi, avec un rappel des droits fondamentaux et spécifiques des personnes handicapées, suivie d’obligation de rapports réguliers effectués par les pays impliqués. Il s’agit donc essentiellement d’accompagner la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’application des droits reconnus au préalable ; c’est là un outil juridique fondamental pour ne pas rester enfermé dans une théorie abstraite et déclamatoire à propos de droits qui ne se concrétisent jamais.
La compensation
Rapport d’information du Sénat n° 306 (2024-2025), « Bilan de l’application de la loi du 11 février 2005 », déposé le 5 février 2025, p. 9 [en ligne].
L’anthropologue Charles Gardou invite ainsi à réfléchir sur le « sentiment d’exister » : « Permettre d’exister aux personnes en situation de handicap requiert, en deuxième lieu, de reconnaître leurs désirs. Le sentiment d’exister, nous l’avons vu, ne consiste pas seulement à combler les besoins de bien-être organique ou ceux nés de la vie en société. Il repose aussi sur l’expression et la prise en compte des désirs : ils ne sont pas un luxe réservé à ceux qui n’auraient pas de besoins « spéciaux ». […] Leurs désirs de relation, de vie affective et d’intimité, de réconfort et de reconnaissance ne se comblent pas en déversant des réponses à leurs seuls besoins, comme on verse du liquide dans une outre. », dans La société inclusive, parlons-en !, Érès, 2012, p. 108-110.
Envisager une société inclusive, c’est commencer par prendre conscience que le handicap limite, voire empêche, l’insertion dans la vie de la société et implique des coûts supplémentaires. Une personne handicapée ne pourra pas forcément suivre une scolarité ordinaire sans aménagements, ni ne sera en mesure de travailler. Il est donc nécessaire de compenser ces obstacles par des aides, notamment financières, qui permettent à la personne handicapée a minima de subvenir à ses besoins et peut-être de réussir à s’intégrer pleinement dans la société, afin de trouver la place de citoyen qui lui revient de droit.
Une meilleure compréhension des besoins des personnes handicapées s’est concrétisée récemment par une ouverture progressive de la PCH. Depuis 2008, sa demande est accessible aux enfants. De surcroît, en 2020, la limite d’âge pour y prétendre a été levée pour les personnes dont le handicap a été reconnu avant 60 ans, puis en 2023 son accès aux personnes atteintes d’une altération psychique, mentale ou cognitive a été facilité33, ce qui témoigne d’un élargissement de la vision du handicap, trop souvent encore restreint aux handicaps physiques et visibles. La compensation n’a pas uniquement pour objectif de pallier les problèmes médicaux découlant de chaque handicap, mais également de permettre aux personnes handicapées d’accomplir leurs projets de vie quels qu’ils soient34. Dans cette optique, plusieurs mesures sollicitées de longue date ont été prises. En 2021, une « PCH parentalité » a été créée pour couvrir l’aide humaine et technique nécessaire aux parents handicapés ; par ailleurs, la déconjugalisation de l’AAH, qui mettait en position précaire nombre de couples comprenant une personne handicapée, est entrée en vigueur le 1er octobre 202335. Ces diverses avancées, offrant une plus grande autonomie aux personnes handicapées, peuvent être saluées.
L’accessibilité au cœur des problématiques
Bertrand Quentin, La philosophie face au handicap, Érès, 2013, p. 149.
Rapport d’information du Sénat n° 306 (2024-2025), « Bilan de l’application de la loi du 11 février 2005 », déposé le 5 février 2025, ibid., p. 80.
Ibid., p. 86.
Rapport d’information de l’Assemblée nationale déposé en application de l’article 145-7 alinéa 3 du règlement, par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur l’évaluation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n° 1692, déposé le mercredi 9 juillet 2025, p. 16-17 [en ligne].
Si l’on souhaite forger une société inclusive, l’accessibilité compte plus encore que la compensation. Étymologiquement, l’accessibilité, du latin tardif accessibilitas, lui-même dérivé du verbe accedo, signifie d’abord « ce vers quoi on peut aller » ou « ce dont on peut s’approcher ». Rendre quelque chose accessible, c’est simplement laisser les personnes s’en approcher, la rendre abordable. L’accessibilité n’est par conséquent pas restreinte au seul champ du matériel comme on l’imagine souvent, il ne s’agit pas uniquement de mettre des rampes d’accès sur des bâtiments ou d’ajouter des sous-titres aux médias audiovisuels. C’est aussi concevoir l’ensemble des activités et des lieux publics d’une société comme devant être accessibles, dans la mesure du possible, à tous les types de handicap. Pour reprendre les mots du philosophe Bertrand Quentin : « L’objectif d’une participation sociale effective implique de promouvoir les capabilités plutôt que de se contenter de verser des pensions pour approcher une égalité des citoyens du point de vue des revenus36 ».
Ainsi, de nombreux domaines, autrefois très fermés, se sont progressivement ouverts aux personnes handicapées après la loi de 2005. Quelques chiffres significatifs prouvent cette amélioration :
– en matière d’emploi, les collectivités territoriales ont vu leur taux d’emploi de personnes handicapées augmenter de 3,42 points de pourcentage depuis 200637 et en 2023, 674.400 travailleurs handicapés étaient employés dans une entreprise assujettie à l’OETH (Objectif d’emploi des travailleurs handicapés)38 ;
– la scolarité des personnes handicapées est en nette progression avec 468.300 élèves à la rentrée 2023, soit trois fois plus qu’en 2006, et 64.000 étudiants handicapés dans le supérieur, ce qui représente une multiplication par huit par rapport à 200339 ;
– de 2014 à 2019 le dispositif des Ad’AP, ou agendas d’accessibilité programmée, a été proposé aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP) qui n’étaient pas encore accessibles aux personnes handicapées au 1er janvier 2015, afin de programmer et financer leur mise en conformité ;
– le fonds territorial d’accessibilité (FTA), doté d’une enveloppe de 5 millions d’euros, a été mis en place par l’État en 2023 afin d’accompagner les ERP de catégorie 5 dans la réalisation des travaux de mise en accessibilité40.
Si les progrès sont donc notables, leur achèvement est toutefois loin d’être atteint.
Quelques préconisations d’amélioration
La volonté de mieux intégrer les personnes handicapées dans la société française est certes présente, mais les concrétisations effectives des droits proclamés demeurent assez peu probantes. Le vingtième anniversaire de la loi de 2005 a permis de dresser un bilan. Le rapport d’information du Sénat parle à ce sujet d’un « bilan en demi-teinte41 ». Pas un mot sur la scolarisation des personnes handicapées, ni sur l’accessibilité des ERP et des transports en commun, et encore moins sur la sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Le constat est plus sombre encore, d’après le rapport récent de la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur l’évaluation de la loi du 11 février 2005, qui décrit la situation comme une « promesse non tenue » et « une ambition contrariée42 ».
Si le problème relève essentiellement de la mise en application de lois déjà créées et ratifiées (1), la scolarisation des personnes handicapées constitue un enjeu majeur de leur insertion sociétale (2), ainsi que la nécessité d’une vraie réflexion sur l’actuel manque d’accompagnement en France (3).
Entre théorie et pratique, le fossé se creuse
Isabelle Mordant, Mystère de la fragilité, Cerf, 2019, p. 5-6.
Drees, « Prestations sociales : pour quatre personnes sur dix, le non-recours est principalement lié au manque d’information », Études et Résultats, n° 1263, avril 2023 [en ligne]. Selon une estimation du site non officiel Mes Allocs, le taux de non-recours irait jusqu’à 61% [en ligne].
Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales concernant le rapport initial de la France, 14 septembre 2021 [en ligne].
Si les lois ont progressé, la pratique ne suit pas toujours. Préfaçant l’ouvrage Mystère de la fragilité d’Isabelle Mordant – mère d’un normalien docteur en mathématiques atteint d’ostéogenèse imparfaite, Cédric Villani décrypte : « L’administration, quand elle fonctionne bien, c’est la façon de définir les règles et processus humains qui assurent la victoire de la raison sur les instincts, du collectif sur l’égoïsme ; mais trop souvent, cela se change en la victoire de la procédure sur le bon sens43. » Les personnes handicapées se heurtent en effet à un mur de complications procédurales pour ne serait-ce qu’essayer d’avoir accès aux droits qui leurs sont dus. Le taux de non-recours à l’AAH est élevé : environ 30% selon une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), qui chiffre sa perception à 1,3 million de personnes fin 202144. La première cause des raisons de non-recours des diverses prestations sociales serait ainsi le manque d’information, suivie par la trop grande complexité et longueur des démarches.
Même lorsque les droits sont connus, la difficulté à les faire valoir est telle que le Comité des droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations unies45 et le Comité européen des droits sociaux46 ont récemment dénoncé de graves violations des droits des personnes handicapées. L’harmonisation avec la CIDPH n’est pas aboutie et de nombreux droits ne sont pas encore garantis, aucune stratégie nationale globale n’étant mise en place.
La scolarité comme enjeu phare
Rapport d’information du Sénat n° 306 (2024-2025), ibid., p.96.
Les problématiques du handicap sont multiples et les préconisations à réaliser innombrables tant le chantier est encore vaste. La scolarité devrait néanmoins faire l’objet d’attentions toutes particulières. Le milieu scolaire condense en effet plusieurs des nœuds qui empêchent les personnes handicapées d’être intégrées dans la société française : stigmatisation, exclusion mais aussi construction d’un avenir. Rappelons que, d’après le rapport du Sénat précédemment cité, le manque de formations demeure le principal frein à l’emploi des personnes handicapées : le pourcentage de personnes bénéficiant d’une RQTH et possédant un diplôme du supérieur est de 29%, contre 47% pour l’ensemble de la population47.
Il est nécessaire de repenser en profondeur l’inclusion des personnes handicapées en milieu scolaire. Une revalorisation du statut des AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap), actuellement précaire et donc peu attractif, serait tout aussi nécessaire que de transformer le lien avec le médico-social, de renforcer la formation des enseignants, souvent démunis face à des situations qui leur échappent, ou encore d’assurer un enseignement en langue des signes française dès les premières années d’école. De nombreuses préconisations ont été pensées par le Comité des droits des personnes handicapées dans sa publication d’octobre 2021, par le rapport d’information n°1692 de l’Assemblée nationale ou encore par le Collectif Handicaps dans son Bilan de la loi du 11 février 2005 : il ne reste plus qu’à les suivre.
Être handicapé en France : un combat permanent
Merwane Mehadji, « La prise en charge de son auxiliaire de vie s’arrête, les études d’Annaëlle menacées », Le Parisien, 2 novembre 2024 [en ligne].
Franck Seuret, « Taux d’incapacité abaissé, revenus diminués : qui sont les déclassés du handicap ? », Faire face, 29 juillet 2020 [en ligne].
Drees, L’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées – Perte d’autonomie et handicap, édition 2024, 9 octobre 2024, p. 79 [en ligne].
Ibid., p. 82.
Ibid., p. 83.
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, « Les grandes familles ou typologies de handicap », 18 juin 2023 [en ligne].
Rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 1692, déposé le mercredi 9 juillet 2025, p. 50-53.
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Enquête sur les préjugés et stéréotypes à l’égard du handicap en France, 15 avril 2021, p. 70 [en ligne].
Drees, « En France, une personne sur sept, âgée de 15 ans ou plus, est handicapée, un adulte sur six et un mineur sur vingt sont proches aidants en 2021 », Communiqué de presse, 2 février 2023 [en ligne].
Parfois, même les droits acquis sont retirés aux personnes handicapées. En témoigne la jeune Anaëlle, qui voit la prise en charge de ses auxiliaires de vie passer sans raison de 100% à 10%48. Le taux d’incapacité de Bruno, atteint de spondylarthrite, descend du jour au lendemain sous la barre des 80% et Hubert perd sa majoration pour la vie autonome49. Ces décisions sont prises sans fondement médical. Le conseil départemental renvoie la responsabilité de prise en charge des auxiliaires d’Anaëlle à l’Université, alors même qu’il n’existe pas d’AESH pour l’enseignement supérieur. Pour Bruno et Hubert, les notifications viennent de la MDPH, sans qu’aucun motif expliquant ces changements ne soit donné, malgré leurs demandes.
Si l’on ajoute à cela les conditions de vie déjà précaires de nombreuses personnes handicapées, la vie devient rapidement une lutte incessante. Au sens monétaire, 25,8% des personnes handicapées de 15 à 59 ans sont pauvres, c’est-à-dire que leur niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, contre 14,4% des personnes sans handicap50. Les privations sont également matérielles et sociales : plus d’une personne handicapée âgée de 16 à 64 ans sur trois est en situation de privation matérielle et sociale en 202251. Le sentiment d’exclusion et de solitude est par ailleurs deux fois plus élevé chez les personnes handicapées que pour le reste de la population52.
Le handicap invisible, qui concerne environ 80% des handicaps53, est particulièrement mal compris, car moins bien identifiable. Il regroupe les maladies chroniques ou invalidantes telles que le diabète (4 millions de Français) et le cancer (3,4 millions en France), les troubles sensoriels discrets, les troubles psychiques et les troubles cognitifs. Si les déficiences motrices touchent 8 millions de personnes, moins de 5% de celles-ci concernent les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Les déficients visuels sont quant à eux 1,5 million, dont seuls 14% sont aveugles, et l’on dénombre 6 millions de personnes sourdes et malentendantes. 700.000 personnes sont porteuses d’un handicap mental ou cognitif, soit 1 à 2% de la population générale. 13 millions de Français sont atteints par une maladie mentale ou un trouble psychique, dont 3 millions avec des troubles psychiques sévères. Leur reconnaissance administrative suffit rarement et nombreuses sont les personnes qui témoignent d’une nécessité constante de justification face aux soupçons de leur entourage personnel et professionnel54. La sociologue Cindy Lebat parle d’une hiérarchisation des handicaps : environ 58% des Français seraient à l’aise avec le handicap moteur contre seulement 36% avec le handicap psychique55.
Face à ces détresses multiples et à un secteur du soin en berne, il est important de réagir. Le grand nombre de proches aidants – 9,3 millions en 202156 – trahit bien une faille dans le système d’accompagnement des personnes handicapées. Un rapport de la Cour des comptes analyse encore le « manque d’attractivité qui se nourrit de la pénibilité au travail57 » des secteurs du soin à domicile. Refonder la politique du soin et de la solidarité devient alors une condition sine qua non d’offrir aux personnes handicapées les moyens de vivre dignement. Le rapport 2025 précédemment cité des députés Le Nabour et Peytavie ainsi que celui des sénatrices Deseyne, Richer et Féret témoignent bien de ces lourdes carences et demande impérativement des efforts substantiels et rapides, depuis trop longtemps attendus. Un enjeu essentiel pour 12 millions de Français.
Une involution inquiétante : le handicap confronté à la reconnaissance d’un droit à la mort provoquée
Texte n° 662 devant le Sénat depuis le 28 mai 2025, proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l’Assemblée nationale [en ligne].
Dans ce contexte, le vote en première lecture par l’Assemblée nationale de deux propositions de loi, l’une portant sur les soins palliatifs58, l’autre sur l’institution d’un « droit à l’aide à mourir »59, permettant l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie pour les personnes ne pouvant s’administrer physiquement la dose létale, inquiète légitimement et tout particulièrement les personnes handicapées et le monde du handicap.
Des silences surprenants aux exclusions dangereuses
Lors des débats devant l’Assemblée nationale, de nombreux amendements ont été déposés pour protéger les personnes handicapées, essentiellement les handicapés mentaux, de la fin de vie provoquée. Si l’inclusion commande de traiter de la même façon les personnes en situation de handicap et les autres, les premières doivent bénéficier d’une protection adaptée à leur état chaque fois que cela est nécessaire. Face à un texte qui n’offre pas de protection satisfaisante aux personnes non porteuses d’un handicap (avec notamment l’absence totale de recours), le soutien renforcé aux personnes en situation de handicap constitue une nécessité. Or, non seulement le texte envisagé ne mentionne pas une seule fois le mot « handicap », mais encore les amendements prévoyant l’exclusion des personnes avec déficience intellectuelle ont tous été rejetés60. Leur objet était pourtant clair et rédigé le plus souvent autour des formes suivantes :
– « ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice » ;
– « les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée lors de la démarche de demande d’aide à mourir ».
L’objet en était clair, ciblé et argumenté. Il ne s’agissait pas de rejeter le principe d’une fin de vie provoquée mais, au regard de la gravité de l’acte, de ne pas admettre des demandes émanant de personnes non susceptibles d’exprimer une volonté libre et éclairée. Les personnes déficientes intellectuellement sont potentiellement éligibles selon les critères pathologiques de l’article 4 de la proposition de loi, mais leur expression de volonté ne sera pas nécessairement éclairée.
Le rejet de ces amendements conduit à s’interroger sur l’idéologie sous-jacente de la rédaction proposée. La proposition de loi prévoyant d’instituer un « droit à l’aide à mourir61 » est présentée par certains de ses promoteurs comme « un pied dans la porte62 » avant d’ouvrir ce droit plus largement, demain, aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de troubles psychiatriques, et aux mineurs. Il ne s’agit donc plus de prévoir une alternative à des souffrances réfractaires. Il s’agit de poser un principe d’autodétermination de sa vie et de sa mort par les citoyens, ce qui relève d’une autre logique. L’autodétermination se heurtera à une vérification de la liberté de l’individu dans sa décision létale. Or le discernement altéré ou fragilisé de personnes souffrantes, isolées, âgées, désorientées, dépressives, en situation de précarité financière, avec des pressions familiales, se sentant une charge pour les tiers, supportant des difficultés de prise en charge, soulève des questions éthiques considérables. En l’état actuel du texte étudié au Parlement, les protections ou vigilances sont quasi inexistantes. Cette situation d’ensemble rend pleinement compréhensibles les inquiétudes des personnes en situation de handicap quant à leur éligibilité aux critères de la loi demain, ainsi que s’agissant des incitations qui pourraient voir le jour. À défaut d’un accès effectif aux soins, la facilitation de l’accès à la mort pourrait être perçue rapidement comme une démarche eugéniste.
Une protection insuffisante
On ne parle plus de juge des tutelles depuis 2020 mais du juge des contentieux de la protection. Cette erreur trahit le peu d’intérêt porté par les rédacteurs à la question des personnes vulnérables, notamment des majeurs protégés.
Projet de loi 112 sur les adultes en phase terminale (fin de vie), présenté par la Chambre des communes, 23 juin 2025, Terminally Ill Adults (End of Life) Bill [en ligne].
Rowena Mason, “Assisted dying bill to get further scrutiny by Lords committee”, The Guardian, 19 septembre 2025 [en ligne]. Le projet de loi sur les adultes en phase terminale (fin de vie) a été adopté de justesse par la Chambre des communes en juin. La Chambre des Lords a approuvé le projet de loi en deuxième lecture sans vote en septembre, ce qui signifie qu’il fera l’objet d’un examen plus approfondi cet automne. Une commission spéciale sera créée pour examiner le projet de loi et présenter un rapport à la Chambre d’ici le 7 novembre 2025.
Certes, la proposition de loi semble bien identifier l’existence d’un risque, puisqu’elle précise en son article 6 que : « La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Mais, de manière surprenante, cet article échoue à déterminer et à encadrer la notion de « discernement […] altéré », d’autant plus que la consultation psychiatrique, mentionnée à l’article 5, n’est pas une condition nécessaire au déclenchement de la procédure.
L’inquiétude est nourrie également de dispositions marginales, issues d’amendements tardifs, et non-opérationnels, qui confèrent à l’ensemble des allures d’alibis.
Témoin du recours offert à la personne en charge de la protection du majeur, le « tuteur » disposera seulement de 48 heures pour agir. Ce délai expéditif est aligné sur le « droit commun » des personnes non porteuses de handicap ou de troubles mentaux pour réitérer leur demande de fin de vie.
Il était nullement justifié de reprendre le même délai puisqu’il ne s’agit pas du même objet : réitérer une demande de mort pour l’un, disposer d’un recours pour contester une décision médicale pour l’autre. Ces deux questions étant différentes, il n’y avait aucune obligation de reprendre ce délai anormalement bref, d’autant plus que les agendas des tuteurs ont leurs propres contraintes et qu’il faudrait un certain délai pour s’assurer de la réception de la demande. Le délai de ce recours exceptionnel le rend parfaitement théorique.
Identification floue du trouble de discernement
Lorsque des fragilités de discernement sont aperçues (encore peuvent-elles ne pas l’être, notamment par un médecin qui légalement n’a pas à être spécialiste de la pathologie du demandeur à l’euthanasie), le médecin peut saisir le « juge des tutelles63 » ou le conseil de famille (article 5 de la proposition de loi). Cette saisine facultative regroupe non seulement deux instances distinctes (un juge et un regroupement de membres de la famille), mais prévoit aussi cette procédure pour un doute sur le discernement de la personne ou un « conflit » (sans que soit précisée la nature du conflit ou le rôle de ses protagonistes). Facultative, cette saisine laisse donc se poursuivre la procédure conduisant à provoquer la mort d’une personne, nonobstant la gravité identifiée du contexte (doute sur le discernement ou conflit). Un tel système n’est pas protecteur.
Ce recours exceptionnel et ineffectif est dans la continuité de l’article 12 de la proposition de loi. Il ne vise que le cas d’un doute sur le discernement de la personne – le conflit n’est pas retenu en l’espèce. Ce recours ne peut être formé que par la personne en charge de la protection, et personne d’autre, dans un délai de deux jours. Ce délai est copié sur le délai de réflexion, alors que les deux délais n’ont rien à voir entre eux. Rappelons que la personne n’est pas mourante et qu’il s’agira surtout de majeurs protégés, au discernement fragile voire absent.
Cette procédure est en outre très en deçà du droit de recours à l’étranger : au Canada et aux États-Unis, des juges ont arrêté des procédures en raison d’une mauvaise évaluation médicale de la situation du patient ; en Espagne, le père d’une jeune fille paraplégique a fait état d’un trouble obsessionnel compulsif entraînant des pensées suicidaires pouvant affecter la capacité de sa fille à prendre une décision libre et consciente. Le recours du père ayant été rejeté par le tribunal de Barcelone en mars 2025, le père a fait appel. Les systèmes de dépénalisation diffèrent selon les pays : l’Espagne prévoit euthanasie et suicide assisté (depuis 2021), le Canada également (depuis 2016) mais dans certains États aux États-Unis, c’est l’assistance au suicide ou le suicide assisté (Oregon et Californie notamment) qui sont autorisés.
Les euthanasies demandées par des personnes dépressives constituent un problème médical, éthique et juridique majeur. L’accueil de demandes de personnes dépressives inquiète fortement les psychiatres et interroge sur la protection des personnes vulnérables par la société et la compatibilité de ces dispositions avec la prévention du suicide.
Un délai expéditif inexploitable
48 heures sont prévues pour former un recours juridique dans des conditions incertaines à des professionnels déjà surchargés. Nous pouvons nous questionner sur le bien-fondé d’un tel dispositif. Le majeur protégé aura été euthanasié avant que son « tuteur » n’ait eu le temps de seulement prendre connaissance du dossier.
Conscient probablement de la fragilité de la protection des personnes en situation de handicap, le gouvernement est intervenu dans le débat sur un point déjà contestable pour les personnes non porteuses de handicap. Il a réservé le droit de recours à la seule personne demandant à mourir (et potentiellement mourante), excluant tout son entourage : parents, enfants, proches, conjoint, personne de confiance, procureur de la République. En l’état actuel du texte, seul le demandeur peut exercer un recours contre la décision du médecin. Or le demandeur n’aura pas le temps de considérer éventuellement que l’acceptation du médecin n’était pas justifiée, il sera mort avant d’avoir pu y réfléchir. En réalité, c’est réserver ce seul recours à une contestation d’un refus médical d’euthanasier. Ce n’est donc pas une protection contre l’euthanasie mais un renforcement de la possibilité d’être euthanasié.
Il n’y a donc aucune protection des personnes face à ces morts provoquées.
Une médiatisation sans réserve
L’ensemble de cette procédure expéditive est envisagé alors que la France n’a prévu aucune mesure, contrairement à d’autres pays (Monaco, Autriche), pour réguler les publicités, diffusions médiatiques ou sur les réseaux sociaux ayant pour objet la promotion de la mort provoquée. Le projet du Royaume-Uni (Assisted Dying Bill64), quant à lui, actuellement en discussion devant le Parlement britannique65, prévoit expressément l’interdiction d’en faire la publicité.
En France, les personnes avec une fragilité de discernement constitueront des victimes faciles sans protection adéquate66.
Le délit d’entrave à l’aide à mourir prévu par l’article 17 de la proposition de loi ouvre, au contraire, la voie à une diffusion que ne pourront entraver des discours prudents ou sceptiques, passibles de poursuites pénales.
L’inquiétude du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH)
Commission sur les soins de fin de vie, Rapport annuel d’activités, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 [en ligne].
Ibid.
Ministère de la Justice du Canada, « La loi canadienne sur l’aide médicale à mourir », 31 juillet 2024 [en ligne].
Ministère de la Justice du Canada, Cinquième rapport annuel sur l’aide médicale à mourir, 10 décembre 2024 [en ligne].
Medical assistance in dying.
Comité des droits des personnes handicapées, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 32e session (3 mars 2025 -21 mars 2025) [en ligne].
Comité des droits des personnes handicapées, Demande d’information du Comité, 23 juin 2025 [en ligne].
La possible dérive de l’euthanasie sur les personnes handicapées doit être prise en considération à la lumière de certaines expériences étrangères.
Dans son rapport d’activité pour 2023-202467, la commission québécoise sur les soins de fin de vie relève que dans cinq cas d’euthanasie, la personne était atteinte d’un handicap, alors que la déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes n’était pas encore permise par la loi (LCSFV68). Cette condition n’est entrée en vigueur que le 7 mars 2024. Par conséquent, avant même que la loi ne soit applicable, on observait déjà une dérive sur les personnes handicapées sans qu’aucune sanction n’intervienne au demeurant. Au Canada, en 2023, alors que l’euthanasie sur les personnes handicapées était légale69, les handicapés représentaient 22% des aides médicales à mourir sur des personnes dont la mort était « raisonnablement prévisible » et 34% des aides médicales à mourir sur des personnes dont la mort n’était pas « raisonnablement prévisible70 ». On voit donc que ce sont des taux élevés par rapport à la population de personnes euthanasiées et que l’euthanasie est appliquée à des personnes qui ne sont pas nécessairement en fin de vie.
La légalisation de l’AMM (MAID71) au Canada en 2016 avait déjà été suivie d’une large extension en 2021, ce qui a conduit le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU à faire part de fortes préoccupations en avril 202572, sollicitant même des abrogations de textes ou de dispositions :
« 20. Pour garantir le droit des personnes handicapées à la vie, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) à abroger la disposition relative à l’aide médicale à mourir (Voie 2), y compris la disposition prévoyant, en 2027, l’application de la Voie 2 aux personnes dont “le seul problème médical invoqué est une maladie mentale” ;
b) à ne pas soutenir de propositions visant à étendre l’aide médicale à mourir aux mineurs matures et aux personnes présentant des demandes anticipées ».
La proposition de loi française suscite une vive inquiétude auprès du Comité en juin 2025, considérant de nombreuses dispositions du texte sur un « droit à l’aide à mourir » particulièrement préoccupantes pour les personnes en situation de handicap. Le Comité a d’ailleurs fait une demande d’information à la France73. Il relève notamment que :
– les critères d’éligibilité du texte sont fondés sur des perceptions capacitistes de la qualité et de la valeur de la vie des personnes handicapées, notamment l’idée que la « souffrance » serait intrinsèque au handicap. Or l’inégalité et la discrimination causent et aggravent la « souffrance » des personnes handicapées ;
– en l’absence d’alternatives à l’« aide médicale à mourir », il n’y a pas de réel choix des personnes en situation de handicap. Manquent notamment : un soutien respectant leur autonomie, leur volonté et leurs préférences, etc. ;
– l’absence de garantie que le consentement n’est pas donné par des tiers, des tuteurs ou des membres de la famille. Les protections contre la coercition, l’abus d’influence et l’abus de pouvoir sont absentes ;
– l’accessibilité des informations fournies aux personnes handicapées n’est pas prise en compte, le Comité attend des moyens et des modes de communication alternatifs disponibles ;
– une interrogation : comment l’État français justifie-t-il l’institution d’un délit d’entrave ?,
– une seconde interrogation : comment l’État français justifie-t-il un délai expéditif de « deux jours seulement après avoir demandé le suicide assisté ou l’euthanasie, pour qu’une personne puisse être légalement mise à mort » ?,
– le processus d’élaboration du texte n’a pas impliqué ni représenté des personnes handicapées et des organisations dédiées ;
– les autorités françaises n’ont pas informé leur population, par la voie médiatique, que le Comité ne soutenait pas une telle législation.
Ce faisant, le Comité ne réagit pas au principe de l’euthanasie ni au seul « délit d’entrave à l’aide à mourir ». Il formule de graves inquiétudes sur un texte ne protégeant pas les personnes, notamment en situation de handicap, et percevant un texte guidé par d’autres motivations que les souffrances en fin de vie. Ces absences de conditions strictes et de protections revêtent une dimension plus visible encore pour les personnes en situation de handicap.
Or, la France a l’obligation d’adopter des mesures garantissant la conformité de sa proposition de loi avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En août 2025, le Comité a examiné toutes les réponses lors de sa trente-troisième session qui s’est tenue à Genève.
Le Comité a émis de sérieuses critiques contre le texte74. Il recommande notamment à la France :
– avant toute adoption du texte, d’effectuer une évaluation approfondie avec la participation active des personnes handicapées, de la conformité de la proposition de loi à la Convention des droits des personnes handicapées de l’ONU ;
– de sensibiliser l’Assemblée nationale, le Sénat et les ministères à la Convention et à ses principes fondamentaux, notamment le modèle des droits humains en matière de handicap et l’obligation pour les États parties de renoncer à tout modèle médical ou discriminatoire ;
– de combler les lacunes actuelles concernant les déterminants sociaux de la santé et du bien-être des personnes handicapées – prestation de services de soutien et de soins en santé mentale, soins palliatifs à domicile, aide personnalisée et soutien à l’emploi ;
– d’empêcher toute nouvelle déclaration publique affirmant que la Convention ou le Comité reconnaissent un « droit à mourir » et de mener une campagne de sensibilisation et d’information sur la Convention et les droits des personnes handicapées ;
– de ne plus faire de médiatisation non encadrée de l’euthanasie ;
– de ne pas adopter le projet avant d’avoir vérifié le respect de la Convention des droits des personnes handicapées, en n’oubliant pas d’associer les acteurs du champ du handicap aux réflexions générales.
Conclusion
La situation générale des personnes handicapées en France en 2025 n’est pas seulement décevante, elle est préoccupante. En effet, l’actuel état financier de la France pourrait aggraver le manque de moyens constaté dans la prise en charge économique et sociale de cette frange fragile de la population. Les recommandations de l’ONU renouvelées en 2021 ne semblent pas suivies d’effets. Il en est de même des suites données aux condamnations du Comité européen des droits sociaux. Plus grave encore, aujourd’hui, les parlementaires travaillent à l’élaboration d’un texte sur l’euthanasie et le suicide assisté, contesté par son manque de protection de la personne handicapée et légitimement redouté si l’on se réfère aux évolutions constatées au Canada et au Québec, notamment. Ce texte privilégierait l’autodétermination individuelle sur la prise en charge des personnes vulnérables. Il produirait des effets dévastateurs sur les personnes en situation de handicap et ferait évoluer notre société dans un sens inavouable.
Une lecture optimiste attendrait un réveil de la population prenant conscience des excès et de certains choix idéologiques et de la nécessité de repenser ses priorités à l’aune de ses valeurs fondamentales : la solidarité, la fraternité et le vivre- ensemble.
La présente contribution a pour objet d’alerter sur les risques dont est porteuse la proposition de loi ouvrant un droit à l’aide à mourir pour les personnes handicapées, absentes de ce débat et n’ayant pas pu ainsi faire valoir leurs droits.


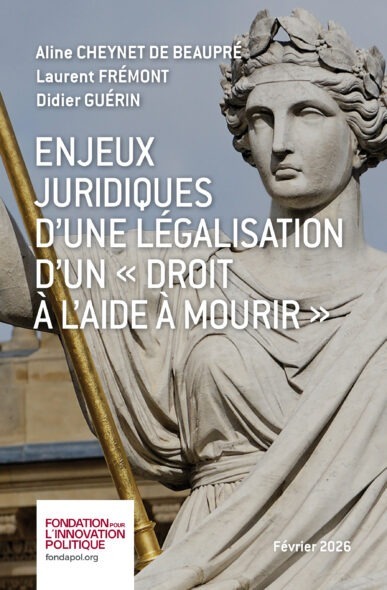
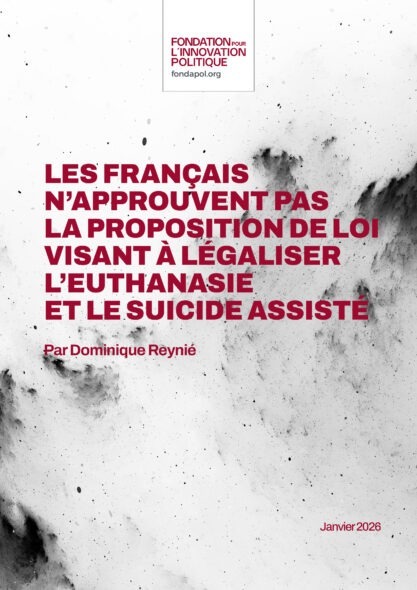






Aucun commentaire.