
Biodiversité : « Le WWF manipule les données ! »
Christian Lévêque | 20 février 2021
Les populations de vertébrés ne se sont pas effondrées de 68 %, comme le clame l'ONG. "Revenons à la science", lance le biologiste Christian Lévêque.
Si la situation est dramatique pour certaines espèces, la notion d’une sixième extinction de masse est fausse, selon le chercheur.
Ses rapports alignent des chiffres tellement alarmistes qu’ils font régulièrement les gros titres, et sont débattus jusqu’à l’Assemblée. « Soixante-huit pour cent des animaux vertébrés ont disparu depuis 1970 », se sont récemment affolés les médias du monde entier, relayant la publication du rapport « Planète vivante » du Fonds mondial pour la nature (WWF) . Le doute n’est plus permis : pour une grande majorité des Français, nous sommes bel et bien au bord d’une « sixième extinction de masse. »
Au même moment pourtant, la publication d’un article dans la revue Nature Communications passera quasiment inaperçue : en exploitant les mêmes données que le WWF, mais avec une méthodologie différente, des chercheurs de l’université d’Édimbourg concluent que, entre 1970 et 2014, seulement 15 % des populations de vertébrés ont diminué en abondance, 18 % ont à l’inverse augmenté et 67 % n’ont montré… aucun changement. Quelques semaines plus tard, un second article, publié cette fois dans la prestigieuse revue Nature, vient éclairer les lourds biais qui entachent la méthodologie choisie par l’ONG de protection de la nature WWF, donnant une image déformée de la réalité. Une « manipulation des données » qui suscite la peur en occultant l’existence de situations bien plus contrastées, avec des gagnants et des perdants, dénonce Christian Levêque, directeur de recherche émérite de l’IRD, et ex-directeur du programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS. Entretien.
Le Point : Comment est construite la méthodologie du WWF ?
Christian Lévêque : Le rapport que publie tous les deux ans WWF, et qui fait référence dans le débat public, établit un Indice planète vivante (IPV) à partir de populations suivies de mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons depuis 1970. La base de données, à laquelle a participé le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), est gérée par la Société zoologique de Londres. Dans son dernier rapport, WWF affirme que les populations mondiales de vertébrés ont décliné de 68 % depuis 1970. Mais ce chiffre est équivoque. D’abord, ne sont prises en compte que certaines espèces, celles qui sont suivies justement parce qu’on s’inquiète de leur évolution. Ensuite, on peut penser que sept espèces de vertébrés sur dix ont disparu, ce qui n’est pas vrai : le pourcentage s’applique à l’évolution moyenne des effectifs globaux, toutes espèces confondues, qui ne correspond pas à la moyenne du nombre d’animaux disparus. Enfin, et surtout, la méthodologie de WWF souffre d’un biais que les travaux scientifiques ont mis en évidence : il repose sur le fait que 2,4 % des populations en très fort déclin pèsent très lourd sur la moyenne, alors que la tendance pour les autres populations serait plutô t à une croissance lé g èrement positive !
Dans la revue Nature, les chercheurs le montrent : en écartant de l’analyse 356 populations de vertébrés ayant connu une diminution particulièrement importante, sur un total de 14 700 étudiées (soit seulement 2,4 % des populations), la tendance moyenne n’est plus en forte baisse, mais en légère augmentation. La réalité est donc beaucoup plus contrastée que ce qu’imagine le public : en dehors de groupes extrêmes, qui ont subi des pertes massives (1 % des populations) ou au contraire de fortes expansions (0,4 % des populations), 98,6 % des populations de vertébrés dans le monde ne montrent aucune tendance globale. On se prive ainsi de pouvoir apporter de bonnes solutions.
Nous ne sommes donc pas au bord d’une « sixième extinction de masse ».
Absolument pas. Il n’est pas question de nier la situation extrêmement critique de certaines espèces. Il est évident que de nombreuses populations, notamment chez les grands vertébrés (éléphants, lions, tigres…), s’effondrent. Mais les chiffres tels qu’ils sont présentés laissent penser que c’est un phénomène général et universel. On manipule une information en fonction de ce qu’on veut lui faire dire. Émouvoir sur un effondrement général génère un stress, une compassion qui sont des leviers puissants pour récolter des dons, mais pas pour agir. Les travaux scientifiques montrent que les situations sont très variables d’un endroit à un autre, selon les espèces, et selon les contextes écologiques.
Vous dénoncez une approche de « science spectacle » contre-productive. Pour quelle raison ?
Car ces moyennes livrées au public, comme si on leur donnait une température globale de la Terre, ne veulent pas dire grand-chose sur le plan écologique. Dans la réalité, au niveau local et non global, les situations sont extrêmement hétérogènes et diversifiées. Cette communication a des conséquences délétères. On aborde la biodiversité comme un stock, comme s’il s’agissait d’un stock de pétrole ou de charbon, en la considérant comme une entité universelle. Mais on ne sait pas le gérer au niveau global, et l’on se prive ainsi de pouvoir apporter de bonnes solutions ! Seules les gouvernances élaborées finement, au niveau local, permettent de régler un certain nombre de problèmes. Si la situation n’est pas parfaite en France, on n’y observe pratiquement pas de disparitions d’espèces. Certaines régressent (comme les hannetons, les papillons…), et nous devons nous demander pourquoi. C’est une vraie question, une question complexe… car la réponse n’est pas globale, et sera différente selon les contextes écologiques, l’urbanisation et les activités et économies des régions concernées. On dit à ce propos que l’écologie est contingente.
La machine scientifique s’est emballée pour mener des recherches essentiellement à charge afin d’alimenter le dossier d’accusation.
La protection de la biodiversité est pourtant aujourd’hui une priorité des instances internationales…
Elle l’est, mais cette approche globale empêche que nous nous posions collectivement les bonnes questions. Le problème de fond réside dans la manière dont on conçoit le rapport des hommes et des non humains. Pendant longtemps, la recherche a fonctionné sur le dogme d’origine mystique selon lequel l’homme détruit la nature… le leitmotiv des ONG américaines. La machine scientifique s’est emballée pour mener des recherches essentiellement à charge (les études d’ impacts, toujours négatifs) afin d’alimenter le dossier d’accusation. Autrement dit, la recherche s’est mise au service d’une idéologie et n’a pas joué son rôle qui aurait été de se poser la question des multiples implications de la cohabitation humains-non humains.
Comment vivre avec la nature dans un monde en pleine explosion démographique, où la pauvreté atteint des niveaux très élevés dans les pays en voie de développement ? Les pays du Nord essaient d’imposer, à l’heure actuelle, 30 % de surfaces d’aires protégées. Comme si l’unique solution envisagée, c’était l’exclusion de l’homme ! Les mouvements militants n’ont pas le privilège de l’ empathie vis-à-vis de la biodiversité, et la vision que les Africains ont des aires protégées n’est pas celle des Occidentaux. Notre vision relève encore d’une conception fixiste et créationniste de la nature. Mais en dehors des milieux européens ultraprotégés, on sait qu’il faut d’abord lutter contre les nuisances que la nature nous cause. Toute l’histoire de l’aventure humaine est jalonnée de luttes contre les prédateurs, les maladies, les événements climatiques extrêmes…
Dans une étude récente que vous avez rédigée pour la Fondation pour l’innovation politique, vous vous inquiétez des impensés du débat public.
Je pense que notre approche globaliste de protection de la biodiversité mène à une impasse. Car nous devrons résoudre l’équation suivante : comment augmenter la surface des aires protégées dans des pays où la croissance démographique est forte et où la demande en espaces agricoles s’accroît en proportion ? Que faire des populations humaines qui vont se concentrer dans des zones de plus en plus restreintes ?
En revanche, si l’on s’inscrit dans la perspective d’une coconstruction à avantages réciproques pour l’humanité et la biodiversité, alors il faut nécessairement rechercher des compromis. Différentes pistes sont possibles, comme de privilégier l’échelle territoriale, en adaptant les actions à mener au contexte local. Il faut pour cela accepter que les objectifs et les priorités puissent différer selon les territoires, ce qui implique une décentralisation des politiques environnementales.

Lisez l’étude Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ? (Fondation pour l’innovation politique, février 2021) sur fondapol.org.




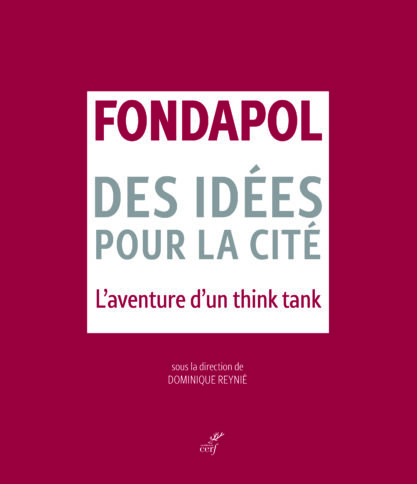



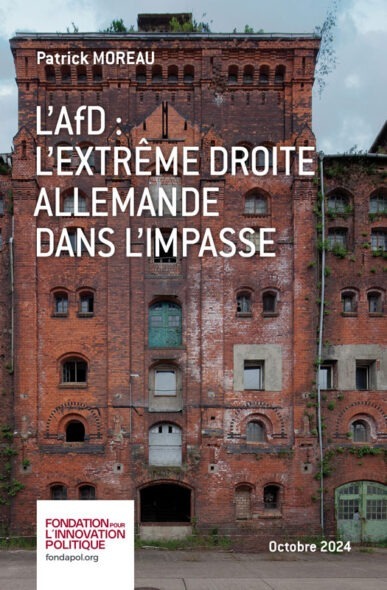



Bonjour Est-il possible de connaître précisément les références des études dont fait état Christian Lévêque (dont j'apprécie les ouvrages ou articles pour leur recul) ? merci Michel Revelin ( je suis auteur de deux ouvrages sur la question du loup et de l'élevage et sur la peur exagérée en écologie)